Esprit, est-tu là ?
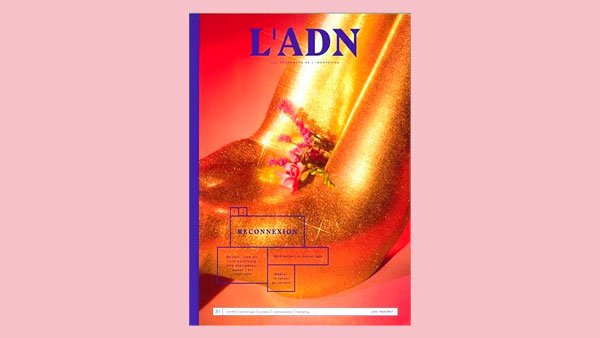
Interview de Yann Boissière
Par Béatrice Sutter pour la revue ADN
La question du genre semble suffisamment déterminante dans le texte biblique pour être adressée dès la Genèse…
YANN BOISSIERE : Certes. Cependant, sur cette question, comme sur d’autres, la Bible n’émet pas un avis global et définitif. Si historiquement il est vrai que certaines positions ont été prises pour organiser la supériorité du masculin sur le féminin, au sein des institutions religieuses notamment, les textes sont en réalité beaucoup plus subtils. La Bible, en particulier, comporte des personnages de femmes très forts, très libres.
Les figures d’Adam et Eve ont longtemps été utilisé pour justifier d’une hiérarchie entre l’homme et la femme.
Y. B. : Quand l’Adam premier apparait dans le texte (Genèse 1, 26-27), il n’est pas l’homme dans sa version sexuée. Il est à envisager en tant qu’être humain, il est androgyne par essence, avec sa part de féminin et de masculin. Dieu lui confie d’abord la mission de nommer les animaux, mais après avoir apposé ses petites étiquettes avec succès, il se sent toujours aussi seul ce qui prouve que le langage ne résout pas tout et que la taxinomie générale n’est pas la solution. Dieu constate alors qu’il n’est pas bon que l’homme soit seul et le fait tomber dans un profond sommeil comme s’il y avait une part d’imaginaire qui ne peut jamais être démêlée dans cette histoire de sexe. Comme le souligne Rachi, l’un des commentateurs on ne peut plus classique de la tradition, Dieu ouvre cet Adam primordial d’un « côté », plutôt qu’Il ne lui prend une « côte », et de cette ouverture naît la femme : Isha. Si on suit le texte, cela signifie que la femme existe avant l’homme, et que l’homme lui est postérieur. Il est très intéressant de constater qu’Ish, l’homme, prend alors la parole pour inverser le cours du récit et déclarer que la femme a été sortie de lui. La tradition nous a ensuite souvent livrée cette version tronquée. Depuis, on n’a eu de cesse de répéter que la femme n’est pas tirée d’une « côte » de l’homme… sans que cela n’engramme vraiment.
Avec l’apparition d’Ish et Isha, nous entrons dans la distinction du masculin et du féminin. Est-ce que le rôle de chacun est défini ?
Y. B. : Si on interroge la mémoire de l’Adam primordial, la séparation de sa part féminine et masculine entraîne un manque qui a été comblé par la parole. Il est intéressant de constater que le masculin – dont la racine du mot hébreu signifie « mémoire » - a toujours du mal à accepter ce manque, et qu’il l’a habillé, occulté dès l’origine par un discours qui inverse la proposition première ! Si on se demande à quoi réfère cette « mémoire » du masculin, eh bien peut-être, justement, de ce souvenir de son androgynéité, et de cette difficulté à accepter qu’il a un autre côté. Le mot hébreu pour le féminin, lui, signifie « creux », et cette première réalité extérieure peut aussi être une difficulté. Etre par principe l’espace de l’ouverture, du vide, complique le fait d’être reliée à un autre sans se laisser assujettir par le discours masculin qui projette sur elle un contre-scénario. Il n’y a pas de hiérarchie de valeurs entre le féminin et le masculin, mais chacun a en propre son fantasme, son risque et sa limite. Le fantasme du masculin pourrait être de penser être tout, tandis que celui du féminin serait de croire n’être rien… Ce sont des choses qui, me semble-t-il, résonnent encore aujourd’hui.
L’épisode du fruit défendu a aussi ancré une certaine idée de la femme tentatrice…
Y. B. : Le second récit (Genèse 3. 1-24) est celui de l’autonomie et de l’incarnation où Adam comme Eve vont devenir opaques au regard d’autrui. C’est sans doute une chose très positive. On ne peut pas savoir ce que l’autre pense, mais cela inaugure la possibilité de l’éthique, c’est à dire la nécessité de communiquer et de se fier à la parole, de prendre le risque de la confiance, le risque de la relation. Mais à ce stade du récit, l’homme et la femme n’ont toujours pas compris que le langage est un outil de communication, ils en sont encore à un langage qui consiste à mettre des étiquettes, comme ils l’ont fait avec les animaux. Au lieu de parler ils se désignent, comme des objets extérieurs – Adam parle d’Eve à la troisième personne : « C’est la femme que tu as mise à mes côtés qui m’a donné de ce fruit, et j’en ai mangé » (Genèse 3. 12) - et la Bible va être féroce sur ce registre. Avec Caïn et Abel cette incompréhension mène au meurtre, et on assiste ensuite à tout un ensemble de ratés du langage. Il faudra attendre Abraham, c’est à dire 10 générations plus tard, pour que le langage puisse avoir une vocation éthique et servir à connecter les individus entre eux. Alors, la question de Dieu posée au Jardin d’Eden va pouvoir devenir utile, et elle demeure fondamentale : « Où es tu ? », qu’on peut entendre comme : « Où en es-tu de ta vie ? ». C’est sans doute la plus grande révélation reçue du jardin d’Eden. Plus que la question de l’homme et de la femme ou que celui de leur autonomisation : la loi qui s’était exprimée comme un élément de pouvoir (audace du récit que de concevoir l’ordre de Dieu battu en brèche !), devient un outil de la connaissance.
Le Cantique des cantiques qui raconte l’amour de deux êtres qui parlent de manière très érotique de leurs désirs et de leur union, marque-t-il un moment de réconciliation du féminin et du masculin ?
Y. B. : L’origine de ce texte attribué au roi Salomon reste très mystérieuse mais aurait pour particularité, selon Julia Kristeva, d’être le premier de la littérature mondiale à faire apparaître la femme s’exprimant en tant que sujet. La Shulamit, dont le nom est le féminin de Salomon, parle successivement de son roi et d’un berger sans qu’on sache très bien si c’est le même homme ou un autre. Ce flou fait tout l’intérêt du texte. On n’est pas dans l’amour platonique, séparé du corps. Le cantique emploie des images sexuelles extrêmement suggestives en référence à l’acte physique, et pourtant il ne s’agit pas non plus des amours orgiaques comme on les trouvait dans des religions à mystère. Le couple vit une relation d’une égalité totale dans la description du désir de la femme et dans celui de l’homme. Il évoque sans cesse la perte de l’objet aimé, et le fait que cet amour, à la fois possible et impossible, se dérobe sans cesse, en fait une description très contemporaine.
Ce texte qui est lu ou chanté tous les vendredis à Shabbat dit il quelque chose de ce pendant féminin dont le Dieu judéo chrétien a été amputé ?
Y. B. : La féminisation de la communauté, assimilée tour à tour comme la fiancée de Dieu ou sa prostituée (chez le prophète Osée, par exemple), est un thème récurrent dans le judaïsme, et les érudits pensent qu’elle est fondamentale puisqu’une divinité doit toujours avoir un associé féminin. C’est une manière littérairement créative de le faire ressurgir.
Dans les textes, comme dans la tradition transmise par les institutions religieuses, on trouve des éléments très clairs qui justifient l’interdit de l’homosexualité, ou la hiérarchisation des rôles entre hommes et femmes. Que faire de tout cela ?
Y. B. : Des choses sont effectivement écrites sur ces questions, et on ne peut pas les ignorer. Par ailleurs, si on veut s’octroyer la possibilité de les interpréter différemment, il faut s’en donner les moyens intellectuels. Au XIXème siècle, les libéraux ont voulu penser cela. Ils ont affirmé que si les textes sont d’inspiration divine, ils ont été écrits par des hommes, influencés par leur contexte culturel. Prenons le cas de l’homosexualité. A deux reprises dans le lévitique (Lévitique XX/13 et Lévitique XXVIII/22), il est écrit : "Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C’est une abomination." Si on prend ces versets de manière littérale, c’est sans ambiguïté. Et pourtant, cela l’est. Ils peuvent s’interpréter de plein de manières différentes car, face au texte, il y a toujours plusieurs attitudes possibles. La première considère que ce qui est écrit est littéralement juste. Cette théorie, degré zéro de l’interprétation, ne tient pas parce que souvent ce qui est marqué ici peut être formulé de manière diamétralement différente ailleurs. La seconde stratégie est celle de l’érudition : on « gratte » l’étymologie des mots, on relativise le verset par son contexte, on cherche en quelque sorte à « l’amollir », à le « noyer » sous une couche d’érudition, comme de dire, en l’occurrence, que le verset parlerait en fait des pratiques rituelles idolâtres, ce qui signifie que l’interdiction ne porte pas sur l’homosexualité elle-même… La 3ème stratégie -- la plus cohérente à mes yeux -- consiste à prendre nos responsabilités face au texte, à le faire résonner avec les standards moraux, la culture et les évolutions qui lui rendent justice à notre époque (pour ne prendre qu’un seul exemple : il n’est plus possible, comme probablement à l’époque biblique, de considérer l’homosexualité comme une pathologie) … Cette possibilité d’évolution, pour le judaïsme, fait aussi partie de la révélation. A nous, donc, dépositaires du texte, de prendre nos responsabilités pour savoir ce que nous décidons. L’alliance entre Dieu et sa création est à ce prix.
S’il ne nous paraît plus possible que les hommes et femmes soit séparées à la synagogue, ou que l’homosexualité soit condamnée, parce que la révélation, par définition, ne peut pas ne pas être éthique… alors nous devons décider que ce n’est plus possible.
La kabbale, la tradition plus ésotérique, porte-t-elle un autre regard sur ces sujets ?
Y. B. : Sur des sujets comme l’homosexualité ou la transgenrité, la kabbale détient des ressources d’une richesse incroyable. Beaucoup de mystiques considèrent par exemple que l’âme a un sexe, et qu’il n’est pas forcément aligné sur celui du corps, et envisagent tout à fait simplement qu’une âme d’homme puisse vivre dans le corps d’une femme. De ce point de vue, ces écrits qui remontent pour certains au 13ème siècle sont d’une modernité folle.
Retournons au Jardin d’Eden. Nous qui en avons été chassé pour avoir bravé l’interdit de manger du fruit de la connaissance du Bien et du Mal, sommes-nous libéré de l’interdit ?
Y. B. : La loi n’est pas seulement un système d’interdits, c’est aussi un système de limites fondatrices. La parole de Paul, ici, pose bien les enjeux : « Tout est permis, mais tout ne me construit pas ». Cela signifie qu’il y a, de fait, des limites à la sphère humaine et à ce qu’est l’homme. La vision d’un homme qui serait l’alpha et l’oméga peut être développée par une certaine pensée de l’internet qui se veut être l’espace de l’illimité. Or la liberté revendiquée sur la Toile est souvent le fruit d’une grande hypocrisie : il y a dans cet espace, supposé collaboratif et horizontal, et dans les organisations qui le promeuvent des personnes qui ont des intentions bien précises, qui dirigent, et qui détiennent le pouvoir. La loi, qui détermine un certain nombre de codes et de règles, y est nécessairement présente, et on ne peut pas en faire l’économie. Le nier est soit une hypocrisie, une illusion ou une grande naïveté spirituelle. L’humain qui n’admet pas qu’il puisse exister une loi limitante ne se permet pas, en fin de compte, de découvrir qu’elle est structurante, qu’elle lui donne un cadre de sens qui l’ouvre à la plénitude.
PARCOURS DE YANN BOISSIERE
Rabbin au MJLF (Mouvement Juif Libéral de France), ses sujets de prédilection le portent à commenter les enjeux sociétaux de l’actualité (mariage pour tous, tensions politiques autour de la cacheroute ou de la circoncision, laïcité, place du religieux dans l’entreprise, médecine et fin de vie). Au-delà de ses enseignements variés sur la tradition, son expertise porte plus particulièrement sur Maïmonide, l’histoire du mouvement libéral et la pensée juive moderne. Il a fondé en 2016 une association inter-convictionnelle, « les Voix de la Paix », qui promeut le vivre-ensemble républicain et fait travailler les religieux de toutes les spiritualités et les non-religieux sur les sujets de société.
1A LIRE
Yann Boissiere, Eloge de la loi, le Cerf, mai 2017