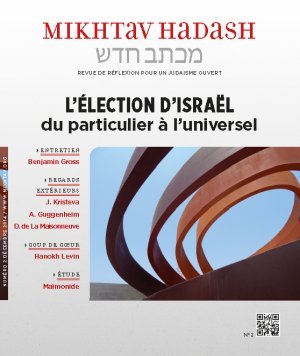L´élection a-t-elle encore un sens aujourd'hiu?
Dans un aperçu bref et clair de l’histoire de la notion d’élection dans le judaïsme, de Koré (Qorah) à Mendelssohn sont analysées, non sans une pointe d’humour, les polémiques cruciales qui jalonnent cette histoire. La prise de conscience de cette histoire nous conduit au temps présent et nous confronte à la difficile question : comment penser l’élection après la Shoah ?
« Dieu n’existe pas et nous sommes son peuple élu. » Cette boutade de Woody Allen exprime à merveille le paradoxe des notions d’« élection » ou de « peuple élu », dont la thématique, même si l’hébreu lui réserve d’autres vocables, irrigue toute la tradition, et où l’abondance d’opinions aussi tranchées que contradictoires atteste de la vivacité.
La croyance rabbinique en l’élection d’Israël pourrait ainsi trouver pléthore de justifications scripturaires ou liturgiques. « Acher bahar banou mi-kol ha-amim » (« qui nous a choisis parmi tous les peuples »), récite-t-on ainsi avant chaque lecture de Tora, une idée également exprimée par les deux versets suivants – parmi d’innombrables : « … ce sont tes pères qu’a préférés l’Éternel, se complaisant en eux ; et c’est leur postérité après eux, c’est vous qu’Il a adoptés entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd’hui. »1 Ou encore : « Car tu es un peuple consacré à l’Éternel, ton Dieu, et c’est toi qu’Il a choisi, l’Éternel, pour Lui être un peuple spécial entre tous les peuples répandus sur la terre »2
Les rabbins du Talmud étaient par ailleurs intarissables sur les raisons supposées de cette élection. Pour certains, il était entendu que la cause était de dimension cosmologique, et l’existence d’Israël prédestinée avant la création du monde. Détaché depuis toujours dans l’idée de Dieu, Israël existe donc encore et de tout temps existera.3 Une autre perspective met en avant l’idée d’une élection réciproque où le peuple, dès la traversée de la Mer Rouge, élit Dieu comme son roi. C’est le thème du double cantique de la mer de Moïse et de Myriam, dont la louange du verset Ex. 15, 18 : « L’Éternel régnera à tout jamais ! », prépare en quelque sorte l’élection divine du Sinaï.
Un autre registre justificatif met l’accent sur telle ou telle qualité particulière que la sagacité divine aurait chérie en Israël : modestie, sainteté, et bien d’autres. Une stratégie interprétative opposée, enfin, préfère éviter les pièges de cette théologie du mérite, pour poser tout simplement l’élection comme un pur acte de grâce de la part de Dieu… La Bible n’avait-elle pas anticipé ce problème ? « Si l’Éternel vous a préférés, vous a distingués, énonce la théologie deutéronomique (plus tardive que celle de l’Exode, et déjà « problématisante »), ce n’est pas que vous soyez plus nombreux que les autres peuples, car vous êtes le moindre de tous ; c’est parce que l’Éternel vous aime… ». C’est ce pur fait de la « chosenness », le « fait d’avoir été choisi », selon l’expression d’E. Borowitz4, qu’enregistre en fin de compte la Bible avec l’expression qui encapsule l’idée d’élection, « am segoula », un « peuple trésor » : « Désormais, si vous êtes dociles à Ma voix, si vous gardez Mon alliance, vous serez mon trésor entre tous les peuples (am segoula) ! »5
La « chosenness », pour la conscience biblique et talmudique, s’exprime avant tout par le don de la Tora
Tout aussi importante que la supputation des causes de l’élection est la réflexion sur ce qu’elle signifie. C’est la perspective adoptée par le présent article, mais il est important de noter en exergue que la « chosenness », pour la conscience biblique et talmudique, s’exprime avant tout par le don de la Tora. Le point est capital car, loin des définitions essentialistes, voire raciales, où la formulation du débat sur « l’élection » se déploiera à partir du XIXème siècle, il rappelle que c’est ce seul paramètre théologique qui fonde la notion d’élection pour la tradition : le fait que Dieu « aime son peuple », qu’il le choisisse ne s’exprime par rien d’autre, selon ces prémices, que le fait qu’il nous donne la Tora.
Le débat, nous le verrons, n’en restera pas là ; nous souhaitons précisément en montrer les grands points d’inflexion, tout comme les tensions à différentes périodes de la tradition. La charge polémique de la notion « d’élection » ne date pas d’aujourd’hui ! Nous montrerons tout d’abord qu’elle pose un problème de compréhension au sein même du klal Israël, avec le débat opposant Qorah à Moïse. Le midrach où Dieu propose sa Tora à différents peuples nous montrera ensuite comment les rabbins tentent d’articuler particularisme et universalisme. Puis, Judah Halevi et Maïmonide nous introduiront à l’expression classique, philosophique, de cette tension, avant que M. Mendelssohn n’en tente une synthèse. Nous nous demanderons enfin sous quelle forme se présente le débat aujourd’hui, à la lumière de l’histoire du XXème siècle.
Qorah et Moïse
Les difficultés liées à la notion d’élection s’expriment déjà dans le récit biblique, lorsque Qorah questionne le leadership de Moïse. Si l’épisode ne concerne pas à proprement parler la question du choix d’Israël par rapport à d’autres peuples, il marque toutefois une difficulté de compréhension inhérente à la Révélation.
Les revendications de Qorah adressées à Moïse se donnent volontiers pour démocratiques : elles exigent, nous enseigne le midrach, la possibilité de servir dans le tabernacle pour tous les premiers-nés, de quelque tribu que ce soit, et non pour la seule tribu de Lévi. Qorah étant lui-même un premier-né, cousin de Moïse et d’Aaron, les commentateurs se font fort de le créditer d’une motivation personnelle supplémentaire : devenir grand-prêtre à la place d’Aaron… En dépeignant sa soif d’honneurs et sa mauvaise foi fondamentale – afin de flatter le peuple et aiguiser son appétit de revendications, Qorah leur assure que « koulam qedochim », « tous sont saints » –, la cause paraît entendue : Moïse – Qorah serait le conflit de l’élu vertueux et du prétendant retors…
Si l’on délaisse cependant l’analyse habituelle pour envisager le discours de Qorah comme une authentique thèse politique et spirituelle, il apparaît que ses revendications se situent dans l’honnête moyenne d’une revendication aristocratique, soucieuse de certains équilibres familiaux et tribaux. Ceci n’exonère pas Qorah de motivations personnelles, mais le point essentiel qu’il convient de retenir relève plutôt d’une question de doctrine, où Qorah apparaît en fait comme un homme du passé. Son problème, en effet, tient à ce qu’il n’a gardé de l’élection que son aspect politique, sans en percevoir la dimension spirituelle.
La conception de Moïse pose la sainteté non comme un fait automatique mais comme le résultat d’un effort, la sainteté comme mérite à acquérir.
Comme le souligne Y. Leibowitz, ce sont deux conceptions de la sainteté qui s’affrontent ici. À la présentation par Qorah de la sainteté comme un privilège de la naissance (« tous sont saints ») s’oppose celle de Moïse, celle des Sages et du troisième paragraphe du Chema : « pour que ces commandements fassent l’objet d’une mémoire et que vous les accomplissiez, et [sous-entendu, seulement alors] que vous soyez saints pour votre Dieu ». La conception de Moïse pose la sainteté non comme un fait automatique, non comme l’héritage aristocratique d’un peuple élu « par définition », mais comme la conséquence d’un comportement, le résultat d’un effort, la sainteté comme mérite à acquérir, comme horizon d’un projet spirituel.
À l’accusation de Qorah selon laquelle Moïse concentre tous les pouvoirs de l’élection, la réponse de ce dernier est capitale : « Les nations du monde, dit-il par le biais du midrach, ont de nombreux prêtres parce qu’elles vouent un culte à de nombreux dieux. Mais nous ne reconnaissons qu’un seul Dieu, et Il a ordonné qu’il y ait un seul Cohen Gadol ».
Cette réponse peut sembler de nature autoritaire, mais elle énonce la justification-clé, qui permet de comprendre l’unicité de la tâche de Moïse – et, par analogie, la situation « d’élection » d’Israël. Elle signifie que l’élection de tel dignitaire ne constitue pas le but en soi du culte, mais un vecteur vers l’Être Un. Le monothéisme est une abstraction quasiment inhumaine, soulignait Georges Steiner ; et l’unité divine, pour nous autres êtres humains, ne peut s’appréhender qu’à travers des singularités. Biaisé par son tropisme du pouvoir, par une grille d’analyse exclusivement pensée en termes de rapports de force, Qorah n’a pas compris que la charge, effectivement unique, de Moïse, n’a rien à voir avec une captation de pouvoir. Il n’a pas vu que cette singularité était une nécessité pédagogique, pour une transmission d’un genre nouveau : une pédagogie de l’unité, pour un Dieu Un.
Cette difficulté de compréhension interne au peuple, on le conçoit aisément, n’aura aucun mal à se voir recyclée en accusations malveillantes, visant de l’extérieur la mission Israël. C’est le type de reproche que cherchent précisément à circonscrire les Sages par le midrach suivant.
Le midrach des peuples
Ce midrach, qui apparait en plusieurs endroits de la littérature rabbinique6, nous présente un Dieu colporteur, cherchant désespérément à trouver acquéreur pour sa Tora. Il la propose à plusieurs peuples – dont chacun la refuse pour des raisons propres –, avant de la proposer à Israël… Dieu propose aux descendants d’Esaü. « Que contient-elle ? » [demandent-ils]. « Tu ne tueras pas [répond Dieu] ». « As-tu oublié la bénédiction de notre ancêtre Esaü « Par l’épée tu vivras » ? [rétorque Esaü] » . [Puis Dieu s’adresse] aux Moabites [le dialogue reprend sur les mêmes bases ; ils s’enquièrent préalablement du contenu de la Tora] : « Tu ne commettras pas d’impudeur ». Les Moabites : « [mais] nous sommes issus de l’inceste ! ». [Puis] aux Ismaélites : « Tu ne voleras pas ». [Réponse des Ismaélites] : « [mais] nous vivons de razzia ! ». Dieu propose enfin sa Tora à Israël qui, sans question préalable, l’accepte en s’exclamant : « Naassé ve-nichma ! » (« Nous ferons et nous entendrons ! »).
De toute évidence, les rabbins sont ici aux prises avec la notion de peuple élu, et tentent d’en redéfinir l’exclusivité en cherchant à éviter l’idée frontale d’une Tora destinée aux seuls Bnei-Israël. L’ingéniosité du midrach, à cet égard, consiste à déplacer le problème en inversant la perspective : il met l’accent non sur l’exclusivité du don, mais sur le mérite de l’acceptation par les Bnei-Israël.
Mais le point décisif vis-à-vis de la problématique de d’élection, c’est le contraste entre les motifs de refus des peuples et celui de l’acceptation d’Israël. Les Nations refusent au nom d’un principe dont ils pensent qu’il constitue leur nature déterminée. Les Nations conçoivent leur existence arrimée à un principe de fondation, dont leur vie politique ne ferait que poursuivre l’inexorable conformité historique. Cette obsession essentialiste les rend dès lors incapables d’accepter une Loi qui les conduirait à se transformer.
On pourra sourire de ce raisonnement voué par avance à faire ressortir le génie d’Israël. Il conviendra de souligner, en revanche, l’originalité inouïe de l’argumentation : à rebours de toute conception essentialiste, le mérite d’Israël est de ne concevoir aucun ancrage préalable dans quelque « génie » ou supériorité propre, et de pouvoir s’ouvrir ainsi aux possibles du projet existentiel qui leur est proposé.
Judah Halévi et Maïmonide
Si la Bible et la littérature rabbinique s’étaient déjà faites l’écho des dissensions vis-à-vis de l’élection et de la mission d’Israël, il ne sera nullement étonnant de voir ces désaccords se poursuivre aux époques ultérieures de la tradition. Le changement radical introduit au Xème siècle au sein de la culture juive, lorsque la pensée rabbinique se voit reformulée selon les catégories de la philosophie grecque, imprimera au débat sa tournure argumentative. Cette tension s’exprime de la manière la plus claire par l’opposition entre les conceptions de Judah Halévi (c. 1075-1141) et Moïse Maïmonide (1135-1204).
Pour Maïmonide, le peuple juif est confronté aux mêmes défis intellectuels et moraux que les autres peuples, et il n’est nul destin particulier à Israël qui serait propre à sa nature, le plaçant à part de l’humanité. Prenons, par exemple, l’un des défis dont Israël a assumé la charge, la lutte contre l’idolâtrie. Le monothéisme, son antithèse, est une lutte contre un biais qui s’enracine dans une tendance humaine générale : l’attachement de l’homme à ses instincts, à ses contacts sensoriels avec le monde, à son « expérience ». Si Israël a pris sur lui d’en traiter avec une constante sollicitude au point d’en faire un « marqueur » de son existence, il n’en demeure pas moins que le problème, en lui-même, est universel. Aussi le peuple juif n’est-il pas pourvu, comme le formule David Hartman à propos de la pensée maïmonidienne,7 d’une « dimension ontologique particulière ». Ses problèmes sont ceux qu’une même psychologie fondamentale applique aux autres peuples.
Cet universalisme s’énonce de manière magistrale dans la lettre du Rambam à Obadia le converti : « Après que tu t‘es réfugié sous les ailes de la présence divine et que l’Éternel t’accompagne, il n’est aucune différence entre nous [qui sommes nés juifs] et toi ».8 Menahem Kellner, soulignant l’universalisme du Rambam, rappelle ainsi qu’il n’est « aucune différence qualitative entre un juif de naissance et un guer tsedeq (un converti sincère) ; les différences halakhiques entre eux ne sont l’effet que d’une conséquence purement technique ; celles-ci ne délivrent aucun enseignement concernant une quelconque supériorité qualitative du Juif sur le non-Juif ».9
Judah Halévi, lui-même philosophe, n’adopte pas une position anti-intellectualiste. Rien dans la Bible, selon lui, n’est contraire à la raison10, mais à la différence de Maïmonide, il rejette la formulation philosophique du divin en faveur du Dieu vivant de l’Écriture. C’est par les miracles, qu’il opère à loisir, que ce Dieu établit le mieux sa légitimité ; sa puissance peut se draper d’autant de mystère qu’il lui plaira. C’est précisément cette existence numineuse du Dieu de la Bible, non réductible à notre raison, qui ouvre à la relation, elle-même mystérieuse et mystique, avec le peuple juif, « son » peuple élu.
L’élection, dans cette perspective, n’a pas à se voir justifiée par de laborieuses analyses apologétiques ou universalistes ; elle atteste de manière directe de la libre puissance de Dieu, et du fait qu’Israël, depuis sa conception dans le projet divin, est porteur de manière quasi-génétique du « inyan elohi », une « sollicitude » divine qui est à la fois le signe de sa faveur, et le marqueur de son génie, de sa supériorité surnaturelle sur les autres peuples.
Cette doctrine aura de nombreux prolongements, notamment chez le Maharal de Prague (1512-1609), ou encore chez Shnéour Zalman de Lyadi (1745-1812), le fondateur du la hassidout Habad.
La conception de Mendelssohn
La modernité juive commence lorsque les Juifs, au sortir des ghettos à la fin du XVIIIème siècle, se trouvent brusquement mis aux prises avec les nouveaux espaces politiques, sociaux et culturels qui leur sont théoriquement proposés, en leur permettant d’y tracer leurs propres trajectoires individuelles. Cette nouvelle donne, qui marque la destruction du kahal, le mode d’organisation communautaire juif traditionnel, change radicalement l’énoncé du problème de l’élection.
C’est à Moïse Mendelssohn qu’il revient de formuler les nouveaux équilibres entre universalisme et particularisme. Il le fait en maskil – en tenant de la Haskala, les « Lumières juives » –, voué à la double mission d’ouvrir le judaïsme traditionnel à la modernité et, en sens inverse, de convaincre la culture environnante de la dignité du judaïsme. L’opération est menée dans son œuvre maîtresse,Jérusalem ou Pouvoir religieux du judaïsme, où tout à sa tâche de rendre le judaïsme « présentable » vis-à-vis de la culture allemande, il s’attache à gommer tout ce qui peut tirer la validité de la loi du côté d’un « entre-soi », d’un exclusivisme de la culture juive.
La grande affirmation de Mendelssohn en la matière est sa maxime selon laquelle le judaïsme n’est pas une religion révélée, mais une législation révélée. Il entend par là que la théophanie du Sinaï ne révèle en aucun cas des vérités éternelles, que celles-ci sont déchiffrables à partir de la Création, accessibles, donc, par le seul don d’observation dont Dieu a doté tout homme et tout peuple : « Le judaïsme, conclut Mendelssohn, ne se glorifie d’aucune révélation exclusive de vérités éternelles indispensables au bonheur… »
La mission du peuple juif serait de conserver une idée pure, non faussée de Dieu
Le « cahier des charges universaliste » étant ainsi couvert par cette irréprochable ouverture aux nations, Mendelssohn se sent tout de même tenu, on le conçoit aisément, de ferrailler sur le volet particulariste : si en effet le Matan Tora (don de la Tora) ne livre aucune vérité distincte, ni ne particularise d’aucune manière le peuple juif par un enseignement spécifique, que reste-t-il de l’élection ? Cette Révélation n’est-elle pas vidée de son contenu dès lors qu’elle n’entretient aucune prétention à la vérité ? Et s’il faut décidément se résoudre à ce dictum, à quoi a-t-elle servi ?
C’est à ces questions tranchantes que sa théorie des Zeremonialgesetze (les « lois cérémonielles ») cherche à répondre. Destinées, on le sent bien, à préserver l’idée que la révélation comporte tout de même quelque chose de spécifique, ces lois constituent, nous dit Mendelssohn, un enseignement sous forme de procédures, une sorte « d’écriture en acte » dont la fonction serait de maintenir le judaïsme comme une religion de l’activité, et ainsi de conserver la pureté de l’idée monothéiste. Face à la « Schreiberei », cette manie des religions de fixer les vérités par des dogmes, lesZeremonialgesetze circonscrivent le danger d’idolâtrie : « La loi cérémonielle elle-même est une sorte d’écriture vivante, éveillant l’esprit et le cœur, elle est pleine de sens, provoque sans relâche l’observation et donne lieu et occasion à l’enseignement oral ».
C’est à ce prix théorique que Mendelssohn parvient à redonner au peuple juif une spécificité que la fuite des vérités éternelles hors du Sinaï lui avait ôté : la mission du peuple juif serait de conserver une idée pure, non faussée de Dieu. Ce morceau de bravoure théorique, quel que soit le succès ou l’échec qu’on lui prête, demeure une des tentatives les plus originales de repenser l’élection à l’aune de la modernité.
L’élection a-t-elle encore un sens aujourd’hui ?
L’esprit moderne, fondamentalement démocratique et égalitaire, a soumis la notion d’élection à une rude critique, dont les points saillants sont l’invraisemblable théologie exigée par un Dieu électeur, et l’indignation devant la piètre appréciation qui semble en résulter vis-à-vis des spiritualités non-juives.11
Sur un plan théologique, la conception d’un Dieu électeur semble à tout le moins entachée d’un anthropomorphisme grossier. Là où l’esprit moderne envisage le cours de l’histoire comme le produit de processus complexes et multifactoriels, l’élection ferait de Dieu l’intrus, le manipulateur qui, tel un marionnettiste, poursuivrait de manière totalement arbitraire sur la scène de l’histoire une sorte de monolâtrie du peuple aimé. En ce sens, la doctrine de l’élection subit le discrédit général de la modernité envers la notion de providence. Elle heurte également l’ethos moderne qui, intuitivement, ressent la captation des dispositions éthiques par un groupe humain particulier comme intrinsèquement immoral.
Enfin, une donnée historique contemporaine aplanit sans doute le relief tant recherché par la tradition autour des valeurs de « distinction » et « d’élection » : l’idéologie postmoderne du relativisme culturel, en mettant systématiquement l’accent sur la « différence » d’une culture donnée, a rendu moins prégnante l’idée d’une distinction du judaïsme. Au rasoir d’Occam du relativisme, la « différence juive » n’est plus qu’un trait commun, banal, de l’idiosyncrasie généralisée des peuples et des cultures.
Pourtant, alors même que les paramètres intellectuels de la modernité semblent porter à une atténuation de l’élection, une donnée massive vient sérieusement tempérer cette évolution : l’ombre portée de la Shoah.
Non pas – écartons d’emblée cette pensée blasphématoire – que la Shoah puisse porter, en une version doloriste extrême de l’histoire juive, une quelconque théologie de la spécificité qui puisse être intéressante. En revanche, il se trouve que le rabbin E. Fackenheim (1918-2003) a consacré des pages importantes à ce problème, posant que si l’événement central du XXème siècle est la tentative de destruction totale du peuple juif, une réponse nécessaire est alors l’obligation sacrée, pour le peuple juif, de survivre.
A priori, comme le souligne K. Seeskin12, que la survie d’un peuple puisse être une valeur en soi, ou le fait de ne pas se souhaiter d’autre valeur que sa propre survie, sont les plus sûres recettes d’une très mauvaise philosophie… Cependant, du fait du bouleversement extrême qu’a constitué la Shoah pour l’existence même du peuple juif, , il y a lieu de croire que cette conception a priori n’a pas cours : la survie du peuple juif est bel et bien une valeur sacrée en soi. Une telle affirmation ne doit pas être comprise comme une simple réponse tribale, mais comme une affirmation de foi en une époque qui a permis l’irréparable.13
Que devient la notion d’élection, dans une telle perspective ? La réponse est loin d’être évidente. Toujours est-il qu’elle représente en quelque sorte le projet, le dessein le plus opposé à la Shoah. À ce titre « l’élection » demeure, de façon paradoxale, une référence absolument nécessaire, ne serait-ce qu’en tant que pôle extrême, pour toute réflexion sur l’existence juive contemporaine.
Conclusion
Il est à porter au crédit du judaïsme d’avoir maintenu fermement les deux pôles conceptuels de « l’élection », l’universalisme et le particularisme, sans chercher à réduire l’un par l’autre, et à chaque époque, de tenter de leur donner une traduction renouvelée et pertinente
Ce parcours cursif de quelques points de fixation du débat sur « l’élection » du peuple juif nous a montré la permanence des deux positions « universalisme vs. particularisme », dont on peut en tout cas affirmer qu’aux côtés de l’héritage grec, elles ont puissament influé sur l’émergence d’une visée universelle au sein de nos civilisations.
L’inclusion de la modernité au sein de la tradition juive au XIXème siècle, les difficiles conquêtes de l’intégration vis-à-vis desquelles les sociétés européennes, bien que que structurées par le droit, manifestent encore jusqu’à aujourd’hui une forte rémanence de l’antisémitisme, et la Shoah, ont irrémédiablement changé le sens des mots. « Élection », « peuple élu » sonnent aujourd’hui comme des expressions chargées d’une sorte d’humour douteux. Elles nous laissent plus que jamais dubitatifs sur la manière d’utiliser ces concepts.
Mais, l’expérience sociale et politique a montré par ailleurs, avec une brutalité dépourvue d’ambiguïté, que toutes les tentatives d’assimilation, ou de dilution de la spécificité identitaire (pour quelque peuple que ce soit), ne sont pas souhaitables et sont de toute façon vouées à un échec total. Il est donc certainement à porter au crédit du judaïsme d’avoir maintenu fermement les deux pôles conceptuels de « l’élection », l’universalisme et le particularisme, sans chercher à réduire l’un par l’autre, et à chaque époque, de tenter de leur donner une traduction renouvelée et pertinente.
Yann Boissière
Yann Boissière est rabbin au MJLF (Mouvement Juif Libéral de France) depuis 2011. Ses études de civilisation anglo-américaine, de linguistique (Universités de Paris III et de Dijon) et de réalisation (Conservatoire du Cinéma français) l’ont conduit à une première carrière dans le milieu du cinéma. Dans les années 1980, il a été lauréat de concours littéraires de nouvelles. De 2007 à 2011, il a effectué des études rabbiniques au Abraham Geiger Kolleg (Berlin), à l’Université de Paris-Sorbonne, à la Conservative Yeshivah (Jérusalem) ainsi qu’à l’Institut Steinsalz (Jérusalem). À son ordination, il a rejoint l’équipe rabbinique du MJLF.
Bibliographie sélective de Yann Boissière
Traduction : Yeshayahu Leibowitz, Les fondements du judaïsme. Causeries sur les Pirké Avot (« Aphorismes des pères ») et sur Maïmonide (Éditions du Cerf, 2007).
Traduction : Yeshayahu Leibowitz, Corps et Esprit. le problème psycho-physique (Éditions du Cerf, 2010)
10 DÉCEMBRE 2014 / Par Yann Boissière
Notes
1. Deut. 10, 15.
2. Deut. 14, 2.
3. Solomon Schechter, « God, Israel, and Election », in Jacob Neusner (ed.), Understanding Jewish Theology. Classical Issues and Modern Perspectives, Ktav Publishing House, New York, 1973, p. 65-72 [p. 70].
4. Eugene B. Borowitz, Renewing the Covenant. A Theology for the Postmodern Jew, The Jewish Publication Society, Philadelphia, New York, Jerusalem, 1991, p. 195.
5. Ex. 19, 5.
6. T. B., Avodah Zarah, 2b-3a ; Sif. Deut 343 ; Nombre Rabba, 14 : 10.
7. David Hartman, A Living Covenant, Macmillan, New York, 1985, p. 93 ; cité par Kenneth Seeskin,Jewish Philosophy in a Secular Age, State University of New York Press, Albany, 1990, p. 214.
8. « Lettre des responsa à Obadia le converti », in Iggerot ha-Rambam [« Les lettres de Maïmonide »], édition Isaac Sheilat, tome 1, Maaleh Adoumim, 1999, p. 234.
9. Menachem Kellner, « Remarques : les corrections caractéristiques dans les écrits du Rambam », in Benjamin Ish Shalom (ed.), Be-darkey shalom [« Les voies de la paix »] : études de pensée juive offertes à Shalom Rosenberg, Beyt Morashah, Jerusalem, 2007, p. 256 [en hébreu].
10. Kuzari, 1.89.
11. Eugene B. Borowitz, Liberal Judaism, Union of American Hebrew Congregations, New York, 1984, p. 59.
12. K. Seeskin, op. cit., p. 214.
13. Ibid., p. 214.