La crise des trois fluides
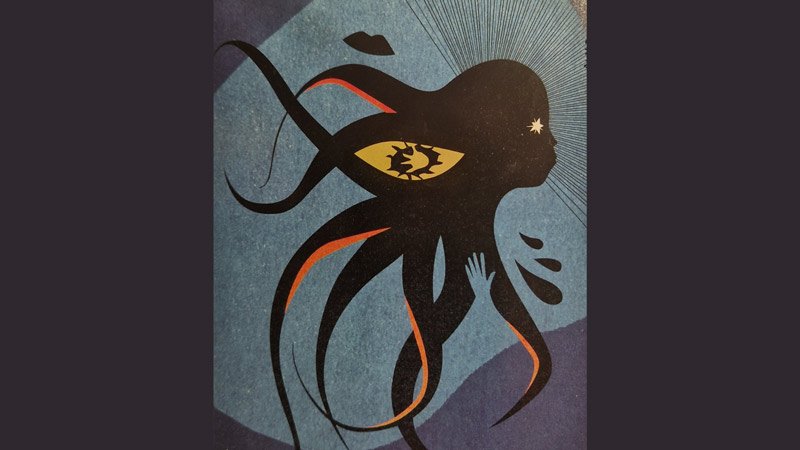
Yann Boissière
Revue « Chema »
« L’eau, l’air, l’argent -- les trois fluides… » : ce bon mot de l’explorateur-écrivain Paul-Emile Victor nous projette au cœur de la « crise de l’environnement ».
A observer les diverses calamités et catastrophes qui se sont abattues sur notre planète et sur notre humanité ne serait-ce que cet été, on peut tout à fait, en effet, requalifier et étendre à bon droit notre compréhension des urgences climatiques et sociétales comme une « crise des trois fluides ». Une crise de l’eau, avec l’asséchement des nappes phréatiques ou au contraire les violentes inondations, une crise de l’air avec l’augmentation, de plus en plus léthale, des températures, des pollutions et des divers dérèglements climatiques, une crise du « fluide monétaire », enfin, avec le retour d’une inflation exponentielle, en particulier des prix de l’énergie. Cette « crise des trois fluides », pourtant avérée et documentée depuis quelques décennies, s’est brusquement imposée à notre conscience collective, cet été, comme une évidence incontournable.
Cette crise de fluidité, de « liquidités », on le comprend, ne nous parle pas seulement de flux monétaires ou énergétiques, mais, comme l’avait déjà formulé il y quelques années le sociologue et philosophe Zygmunt Bauman, de quelque chose qui a trait à notre manière de vivre : elle nous parle de nos « sociétés liquides ». Dans sa critique sans concession de la modernité, Zygmunt Bauman pose son concept-phare : la « société liquide », ou « modernité liquide. » Deux de ses conséquences, en particulier, sonnent si justes pour notre temps : tout d’abord, la célébration tous azimut de l’autonomie et de la responsabilité individuelle nous place devant une injonction paradoxale : elle contraint chacun à régler des problèmes localement alors que ceux-ci n’ont de solutions que collectives. Par ailleurs, la consommation, qui a pris définitivement le pas sur la production dans nos sociétés -- et sur un plan individuel, devient l’unique facteur d’identité et de sociabilité--, a pour conséquence que les valeurs et les normes tendent à s’effacer devant le marché et sa fluidité.
Le constat sonne si juste… Car la question qui se pose à nous, bien sûr, c’est « que faire ? » Que faire, devant l’empilement des événements dramatiques, pour dépasser notre désolant sentiment d’impuissance ? Pour aller au-delà de la compassion ponctuelle envers les victimes qui nous envahit à chaque drame, et dont on sent bien qu’elle ne nous permet pas non plus d’être vraiment utile, face à des problèmes complexes dont les tenants et les aboutissements nous échappent ?
Bien sûr, le judaïsme, depuis cette scène inaugurale où l’homme, au Jardin d’Eden, reçoit la mission de « travailler et de conserver » la terre où il vit, possède tout une gamme de profonds enseignements à valeur écologique : toute la symbolique de Tou-bi-Chvat, la Fête des arbres, celle du « bal-tash’hit », qui nous commande de « ne pas détruire » nos ressources (y compris celles de nos ennemis en temps de guerre !), le respect de la vie animale, celle de la Chemitta (« jachère ») et du Yovel (« jubilé »), autrement dit le souci d’une redistribution de la richesse pour ne point se laisser déborder par les inégalités -- pour ne citer que les enseignements les plus connus. Mais une fois que l’on a dit cela, notre conscience en est-elle apaisée ? Invoquer ces magnifiques leçons, nous le savons bien, ne suffit pas, car nous sommes embarqués, aujourd’hui, dans une histoire globale bien plus puissante que telle ou telle conviction, un mouvement qui nous noie dans la fluidité générale, et qui, malgré nos meilleures intentions, nous laissent, à chaque urgence, sidérés.
Nous savons, aujourd’hui, que l’idéologie de la fluidité est léthale. Et que si la « maison brûle », nous devons changer notre manière de vivre. Face à la crise des « trois fluides », dans cette « société de l’attention » où nos cerveaux sont aimantés et excités en permanence, il est cependant un facteur d’espoir, de confiance, et sans doute une marge de manœuvre possible. Elle provient d’un autre enseignement du judaïsme : la granularité…
De quoi s’agit-il ? Le judaïsme, en effet, met l'accent, non sur des concepts, sur des grilles d’analyses ou des programmes d’action tout faits, mais sur la confiance en certains « blocs d’expérience » capables d’offrir une certaine résistance aux événements. On pensera ici à la famille, à la notion de peuple, à la mémoire, au rite, à l’étude régulière des textes, à la pratique de l’interprétation et de la pluralité des voix. « So what ? », diront les sceptiques ! Précisément. Là où l’esclavage de la « fluidité » nous place en court-circuit permanent -- et le plus souvent en incapacité d’agir--, ces « mini-blocs de stabilité », ces « granularités » à la mémoire longue sont peut-être nos meilleurs garde-fous. Certes, ils n’agissent pas directement sur les problèmes, mais de manière plus profonde, et finalement plus efficace, ils agissent sur notre humanité. Cette « sagesse pratique » de la tradition nous évite de vriller immédiatement dans l’idéologie, ou de nous livrer en pâture intégrale aux événements. Les facteurs d’inertie et de médiation que sont la famille, les rites, le peuple et l’étude -- lesquels, il est vrai, peuvent aussi devenir des facteurs de conservatisme--, jouent ainsi une fonction extrêmement utile d’amortissement et de résistance aux idéologies, et à cet esclavage, dévorant aujourd’hui, qu’est la « liquidité » du monde.
Face à la « crise des trois fluides », la « granularité » de ces petites pépites que la tradition propose à notre devoir de mémoire, mémoire de notre dignité, est encore peut-être notre meilleure leçon de liberté. L’urgence des drames, malheureusement, ne se dissout pas dans la conscience que l’on peut en avoir, mais travailler notre humanité, c’est aussi travailler notre capacité à agir. Kafka, encore et toujours : « Du Bist die Aufgabe », « tu es ta propre tâche ! »
Yann Boissière – CHEMA -- La crise des trois fluides