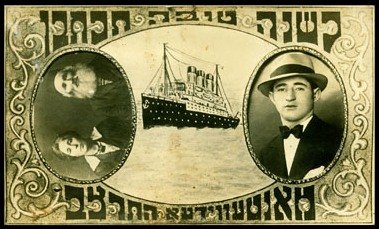Loin d’un monde en deux dimensions, entre un passé figé et un future incertain, le rabbin Yann Boissière nous invite à explorer notre troisième dimension : notre intériorité
« Quand Dieu a quitté la terre il a oublié la loi
chez les Juifs et depuis, ils le cherchent
et l’interpellent à grands cris : tu as oublié quelque chose,
tu as oublié,
Et les autres hommes pensent que ces cris sont
la prière des Juifs.
C’est depuis lors qu’ils s’acharnent à trouver dans la Bible
Des indices
du lieu où il se trouve comme il est dit : « Demandez à Dieu
où il se trouve
appelez-le pour qu’il soit proche. » Mais il est loin. »
Dans ce poème, Yehuda Amichaï, z’’l, nous livre une vision saisissante de la Loi, et de la prière. Il en inverse, tout d’abord, la perspective habituelle. Là où nous pensons volontiers la prière comme une parole positive, une activité qui articule, de manière volontaire, des propositions, des espoirs, des inquiétudes, qui cherche à affirmer la vérité de nos âmes tout autant que les valeurs de nos textes, Yehuda Amichaï la transforme en un appel tout ce qu’il y a de plus prosaïque, un appel à reprendre un objet perdu ! Ironie supplémentaire, il suggère que nous ne comprenons pas que cet objet, la Torah, dont nous n’imaginons rien de plus urgent que de rappeler à Dieu qu’il l’a oubliée, est celui qui en fait nous était destiné. Mieux : persistant dans notre méprise, ou peut-être de guerre lasse, nous finissons par chercher en elle le moyen de retrouver le divin étourdi pour le lui redonner. L’étude de nos textes serait ainsi le résultat d’un sublime quiproquo théologique, qui dure depuis quelques milliers d’années : la recherche d’un propriétaire, sans réaliser qu’il s’agit en fait d’un généreux donateur…
On reconnaît ici l’humour dévastateur de Yehuda Amichaï, mais j’aimerais partager, avec vous ce soir, que ce texte pointe quelque chose qui est au cœur de Rosh ha-Shanah. Apparemment, Rosh ha-Shana a tous les attributs d’une Fête simple, puissante, solennelle et joyeuse. Simplicité d’un spectaculaire changement de millésime, passer de 5782 à 5783, à laquelle répond la claire et puissante célébration de la création de l’homme -- un jour anniversaire, donc, que nous instaurons, raisonnablement confiants, comme un premier jour de l’année, vibrante prémisse d’un avenir renouvelé. A y regarder de plus près, pourtant, Rosh ha-Shanah est une fête fondée sur de nombreux mystères et, bien davantage qu’une affirmation volontariste, une fête de la dissimulation, des choses cachées. Comme nous le verrons, c’est précisément cette dissimulation qui permet à Rosh-Shanah de déployer deux de ses notes les plus puissantes : celle d’un jour de création, affirmée par la liturgie, « ha-yom harat olam », « C’est aujourd’hui qu’est engendré le monde », et celle d’un jour de jugement, « Yom ha-Din ». Et c’est aussi cette dissimulation, ce mystère des choses cachées qui vont nous permettent de travailler sur nos manquements -- ce qui nous a manqué, et ce qu’il a manqué de nous--, et d’aller vers notre jugement, pour nous renouveler.
Le mystère de Rosh ha-Shanah, tout d’abord, est inscrit dans nos textes.
En premier lieu, l’expression « Rosh ha-Shanah », « tête de l’année », n’apparaît nulle part dans la Torah. Celle-ci mentionne simplement un jour particulier, le « premier jour du 7ème mois », sans préciser son nom et, si le verset énonce qu’il s’agit du « jour de la sonnerie » (Nbr. 19, 1-6) et, dans un autre passage, plus énigmatique encore, du « jour de souvenir de la sonnerie » (Lev. 23, 24-25), la Torah n’en fournit aucun détail, ni aucune signification. Quant à sa compréhension en tant que jour de l’an, il semble qu’il s’agissait-là d’un fait d’ancré dans la mémoire collective, où tout le monde savait, à l’époque biblique, que ce « premier jour du septième mois » était en effet le jour de l’an, sans que jamais cela n'ait été précisé nulle part. Quant aux deux significations majeures de Rosh ha-Shanah aujourd’hui, un jour anniversaire de la création de l’homme, et un jour de jugement – il faudra de longues et complexes élaborations ultérieures, dans la littérature rabbinique, pour les établir.
Autre incertitude : celle qui s’exprime par la controverse, au traité Rosh ha-Shanah, entre Rabbi Eliezer, pour qui l’homme a en effet été créé en Tishri, contredit par Rabbi Yehoshua, pour qui Adam a été créé en Nissan, mois de la libération d’Egypte… La préséance, de fait, sera laissée à Nissan quand il s’agit de compter les mois. Tishri n’est donc bien que le septième mois : étonnant jour de l’an !
Enfin, le caractère de mystère de Rosh ha-Shanah semble porté à son comble dans cette injonction du Psaume 81, abondamment reprise par notre liturgie :
| ד תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר; בַּכֵּסֶה, לְיוֹם חַגֵּנוּ. | 4 sonnez le Chofar à la nouvelle lune, au jour fixé pour notre solennité. |
| ה כִּי חֹק לְיִשְׂרָאֵל הוּא; מִשְׁפָּט, לֵאלֹהֵי יַעֲקֹב. | 5 Car c’est une loi en Israël, une coutume en l’honneur du Dieu de Jacob |
« Sonnez du shofar », dit le verset, « Ba kessé », mal traduit par « à la nouvelle lune », car signifiant « couvert », « enveloppé », « caché ». Si les mois hébraïques, en effet, se renouvellent après que la lune a grossi jusqu’à une pleine lune, puis diminué jusqu’à son moment d’invisibilité, le mot « kessé », dans notre verset, met l’accent non sur ce renouvellement, mais sur l’invisibilité elle-même. Le shofar, ce son primaire du fond des âges, doit être sonné à l’exact moment de la pliure du temps, cette virgule suspendue entre le mois qui vient de mourir et le mois qui n’est pas encore venu, entre inspiration et expiration, au cœur du mystère, au moment où tout est voilé, enveloppé, invisible…
A première vue, cette dissimulation ne constitue pas pour nous une nouvelle exaltante, en tout cas de nature à nous aider à passer l’épreuve. Car A Rosh ha-Shanah, jour de jugement, ne l’oublions pas, trois livres sont ouverts : « un pour les méchants parfait, un pour les justes parfaits et un pour les moyens. Les justes parfaits sont immédiatement écrits et scellés pour la vie, les méchants parfaits sont immédiatement écrits et scellés pour la mort. Les moyens restent en suspens entre Rosh ha-Shanah et Kippour : s’ils se révèlent méritants, ils sont inscrits pour la vie, s’ils ne le sont pas, ils sont inscrits pour la mort. »
Notre problème est donc le suivant. A Rosh ha-Shanah nous nous tenons sur le seuil. Le jugement s’exerçant selon une double direction, le passé et le futur, nous sommes en quelque sorte coincés entre ces deux dimensions du jugement : un passé déjà inscrit, dont nous ne pouvons rien effacer, et un futur, par définition insondable, indécis, sinon improbable. Comment sortir de cette impasse ? C’est précisément là où Rosh ha-Shanah, du sein de son voilement, va révéler sa puissance de création humaine… Rosh ha-Shanah va révéler pour nous une dimension cachée et, circonvenant l’étiquette figée du passé et du futur, va créer pour nous une troisième dimension, salvatrice, qui permettra le jugement.
Mais avant d’en dévoiler la teneur, j’aimerais ici rapporter une histoire qui rend compte, précisément, de la possibilité de révéler une telle dimension cachée -- non pas simplement comme le ferait une habile métaphore littéraire, mais de manière tout à fait concrète. J’avais lu, il a quelques années dans une revue scientifique, un article qui cherchait à faire comprendre au non-spécialiste comment certaines recherches théoriques de la physique contemporaine travaillent sur des hypothèses de monde à n dimensions -- jusqu’à 12 dimensions, autrement dit, bien au-delà des trois dimensions de notre vie de tous les jours. Pour rendre compte de leur possibilité -- des dimensions réelles, insistait l’article, mais dont nous ne sommes tout simplement pas conscients--, il prenait l’exemple suivant. Imaginons un homme qui marche sur une corde, une corde positionnée à trois mètres de hauteur. Pour cet homme n’existe que deux dimensions : avancer ou reculer, aller vers l’avant, ou aller vers l’arrière. Aucune autre dimension n’existe pour notre camarade funambule, plus exactement, tout autre possibilité (aller vers le bas, par exemple, autrement dit chuter) signifie la fin de son expérience, et selon toute probabilité, de son existence. Pourtant, une troisième dimension existe bel et bien. Imaginons, en effet, une fourmi qui se promène sur cette même corde. Tout comme son acolyte funambule, elle dispose de la dimension de « l’avant », et de « l’arrière ». Sa petite taille, toutefois, lui permet d’en expérimenter une troisième : l’épaisseur de la corde, son diamètre, dont elle peut tout à fait entreprendre de faire le tour, et en expérimenter le parcours. Pour la fourmi, la rotondité, l’épaisseur de la corde est une troisième dimension tout à fait réelle, et praticable, elle fait partie intégrante de son expérience, et de ses choix possibles.
De la même manière, pour nous autres êtres humains, les dimensions de notre expérience sont déterminées par les possibilités pratiques que nous pouvons imaginer vis-à-vis du monde, qu’il s’agisse d’objets ou de situations. Notre conscience ne nous emmène pas au-delà, elle ne voit pas les dimensions cachées de l'existence – qui pourtant existent -- parce que globalement, nous ne nous projetons pas au-delà de ce dont nous avons besoin.
Si l'on applique, maintenant, cette sorte de loi existentielle à la situation de jugement de Rosh ha-Shanah, il apparaît que nous nous trouvons dans la situation du funambule. Notre marge de manœuvre y est réduite à deux dimensions, assignée aux deux catégories massives, indubitables, et en un sens indépassables de notre existence quotidienne : le passé et le futur. Vision peu rassurante, car c'est sur ces deux seules dimensions, apparemment que nous serons jugés ! Mais comme nous le disons précédemment, « Ha yom harat olam » ! Rosh ha-Shanah n’est-il pas le jour de la création de l’homme ? Plus exactement, c’est le jour où une dimension cachée lui est révélée, le jour où notre troisième dimension fut créée : notre intériorité.
Face aux masses de granit du passé et de futur, intangibles domaines, la dimension cachée, celle de notre liberté, c’est notre intériorité. La perspective qu’elle dessine ne nous cantonne plus au triste calcul de l’avant ou de l’arrière, mais ouvre une direction vers nous-même, vers un intime dont les infinies ressources ne dépendent plus de causes, mais de notre conscience.
L’espace extérieur, lui, fonctionne comme selon le Psaume 90, 12 :
| יב לִמְנוֹת יָמֵינוּ, כֵּן הוֹדַע; וְנָבִא, לְבַב חָכְמָה. | 12 Apprends-nous donc à compter nos jours, pour que nous acquérions un cœur ouvert à la sagesse |
Dans l’espace extérieur on y compte, on y soustrait, on y ajoute, on y brandit des objets visibles, on y proclame joyeusement, « 5783 ! », sans trop saisir ce que nous voulons dire par là… Mais dans l’espace intérieur, celui de la spiritualité, celui dont Kafka disait, « Du Bist die Aufgabe », « tu es ta propre tâche », règne une logique de l’infini nuance, faite de bruissements et de souffles obscurs, de « sons brisés » tels la terou’a du Shofar, un royaume d’ombres, moins objectives mais non moins essentielles. Dans l’espace extérieur, on compte les objets, dans l’espace intérieur on compte sur soi. Ici règne le temps du « kessé », du recouvrement, celui où l’honnêteté exigeante a aussi valeur d’appel à la confiance. C’est ici l’espace du regret, qui va permettre le pardon, une mathématique intérieure dont les signes ne sont plus l’addition ou la soustraction, mais l’exacte position de la conscience, qui dès lors permet le retour, la teshouvah, la transmutation de soi, et où la reconnaissance des manquements est garante de l’engagement nouveau.
L’examen intérieur n’est en rien un exercice de contrition. Ce qui nous est demandé, c’est, par la reconnaissance de nos actes, non pas de nous engoncer dans l’amer ressassement de nos tristes exploits, mais de risquer le courage de l’altérité, l’altérité de soi-même ! Abandonner la complaisance pour l’audace de nous voir différemment : telle est l’efficace du « kessé », de ce qui se cache. Ce qui « couvre » permet aussi de « recouvrer », au sens de « recouvrer » la santé. « La volonté, a pu dire Schopenhauer, c’est la causalité vue de l’intérieur ». A Rosh ha-Shanah, la dure causalité du monde extérieur se découvre, en nous-même, comme une volonté. En reconnaissant nos fautes, et en les regrettant, nous ne les supprimons pas ; simplement, nous requalifions les dettes du passé en devoirs pour l’avenir. C’est à ce courage que répond Dieu – du moins nous l’espérons --, et sa reconnaissance de notre courage se nomme miséricorde. C’est donc en pleine invisibilité de la lune, dans la dimension supplémentaire, cachée mais réelle, de l’intériorité, que Dieu déverse sa compassion. Il suspens la comptabilité du doute, et consent à garantir notre pari sur l’avenir : ce moment de grâce, cette suspension de la balance des dettes et des mérites, et du fléau de la causalité, la tradition le nomme pardon.
Comme l’avait vu Yehuda Amichaï, il se peut, ainsi, que nous criions -- un peu plus fort à Rosh ha-Shanah--, « Tu as oublié quelque chose, Tu as oublié ! ». Mais c’est un cri de soulagement, de reconnaissance, et peut-être de joie : la conscience que Dieu, oui, oublie, non pas nos actes, non pas la vérité de nos consciences, mais à tout le moins en suspend le compte mécanique, le compte à charge. Ce que Dieu délaisse, à Rosh ha-Shanah, c’est le « olam ha-zé », le « monde du ceci », le monde du « c’est comme ça », pour laisser au place au « olam ha-ba », le « monde qui vient », le monde du « cela pourrait être autrement ».
Un autre poète, Paul Eluard, le chantait : « Il y a un autre monde mais il est dans celui-ci ». Ce monde, nous dit Rosh ha-Shanah, c’est nous-même. Alors que la lune, au lieu d’enchaîner mécaniquement le mois suivant, l’année suivante, le destin suivant, fait semblant de bégayer pour nous laisser le temps de la reconnaissance, Rosh ha-Shanah, ainsi, fait naître le jugement. Dans la pliure du temps, Dieu se plie vers nous, nous nous plions vers lui, et nous affirmons en pleine reconnaissance qu’un avenir de justice, justice envers les autres, justice envers nous-même, est possible.
Le-shanah tovah tikatevu !