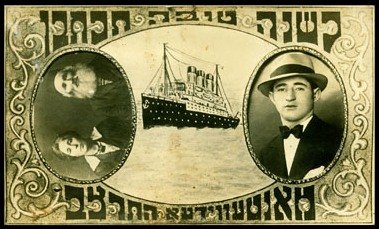Nous sommes à la fin du 19ème siècle, à Targu Mures, une grosse bourgade de Transylvanie, aujourd’hui en Roumanie mais à l’époque partie de l’empire austro-hongrois. Le rabbin de la communauté, que tout le monde appelait Rabbi Dov, était un pieux parmi les pieux, un saint homme vénéré par moult disciples. Certains venaient de contrées lointaines, simplement pour le scruter dans son quotidien, tant le moindre de ses gestes, nouer un lacer, prendre un repas, prodiguer la tsedaka, recelait, disait-on, des prodiges d’enseignements.
En cette période de préparation des Grandes fêtes, la ferveur de rabbi Dov semblait redoublée, et l’afflux des hassidim, avide d’en recueillir quelque étincelle de sainteté, décuplé. C’est ainsi que la veille de Kippur, après l’office du matin, un disciple, manifestement venu d’au-delà des Carpates, sollicita audience : « Me permettrez-vous, Rabbi, supplia-t-il, de rester auprès de vous toute la journée et d’observer comment vous accomplissez le rituel des kapparoth ? »
Pour ceux qui n’auraient plus une mémoire fraîche de cette pieuse pratique, rappelons que le rite des kapparoth consiste à faire tourner un poulet vivant trois fois au-dessus de sa tête, et à demander expiation de nos péchés en récitant les formules d’usage. Le bienheureux volatile, par la suite sacrifié et donné aux pauvres, se voit ainsi symboliquement transféré nos péchés, jouant le même rôle que le bouc envoyé au désert vers Azazel.
Rabbi Dov répondit à la demande du hassid : « Ma pratique des kapparoth n’a rien de bien spécial, vous savez. Je saisis mon poulet d’une main, mon livre de prière de l’autre, et je récite mon texte, comme tout le monde : « zé halifati, zé temurati, zé kapparati », « ceci est mon échange, ceci est ma substitution, ceci est mon expiation », vraiment, rien d’extraordinaire… »
Le disciple ne voulut pas se fier à tant de modestie, mais alors qu’il insistait auprès du rebbe, celui-ci coupa court en ajoutant : « Je sais ce qui peut t’intéresser. Je connais quelqu’un, à quelques mils d’ici, qui accomplit les kapparoth les plus extraordinaires qui soient : elles sont beaucoup plus originales que les miennes, et son intercession auprès de notre créateur beaucoup plus efficaces. Il s’agit de Zussia, le tavernier, tu trouveras son auberge à une heure de marche d’ici, sur la route qui mène à Sighişoara. »
De fait, une heure plus tard, à la tombée du soir, notre hassid arrivait en vue de la dite auberge, et demanda à y passer la nuit. Zussia, un homme d’une corpulence extraordinaire, mais à la voix d’une douceur infinie, s’excusa en ces termes : « Malheureusement, mon établissement est minuscule, et je n’ai plus de de chambres de libres ». Le hassid insista : « J’ai marché toute la journée, et je peux tout à fait dormir à même le sol, dans un coin de la salle à manger, je ne prendrai pas de place ». Zussia le tavernier finit par se rendre à ses supplications : « C’est d’accord, dit-il. Je vais bientôt fermer, et vous pourrez alors vous installer dans le recoin, à gauche de la cheminée ».
Quelques heures plus tard, après que Zussia, au prix de quelques insultes, voire quelques coups de pieds, ait forcé le chemin d’un dernier carré d’ivrognes vers la sortie, la salle commune était redevenue calme. Baignée dans l’obscurité, elle bruissait du doux ronronnement des braises dans la cheminée. A quelques mètres, pelotonné dans le recoin, notre ‘hassid faisait semblant de fermer l’œil ; il était aux aguets, en réalité, du moindre bruit en provenance du tavernier.
Aux heures blanches du matin, une heure avant l’aube, il entendit enfin Zussia chuchoter pour réveiller sa femme : « Gittele, debout ! C’est l’heure des kapparoth ! »
Le ‘hassid, au niveau du sol, se redressa légèrement ; l’œil grand ouvert dans le noir, il ne perdit rien de la scène, et ce qu’il vit le laissa stupéfait. « Gittele, dit alors Zussia à sa femme, apporte-moi le carnet, là-bas, posé sur le bahut ». Sa femme le lui tendit, et Zussia, assis sur un tabouret bas, à la lueur d’une bougie, commença alors à se balancer en faisant monter sa voix, une voix pleine de douleur.
Il lisait, en fait, les notes de son carnet, où il avait consigné la liste de toutes ses mauvaises actions commises au long de l’année passée. Oh ! Il ne s’agissait pas de bien grands péchés, une dispute par ci, un retard à la schul, à la prière du matin par-là, ou encore, avoir négligé de donner la tsedaka en telle occasion… Chaque fait était accompagné de la mention du jour, de l’heure, du nom de la personne offensée. En atteignant les dernières pages du carnet, Zussia s’effondra, terminant sa lecture en pleurs.
Alors il se tourna vers sa femme et lui dit : « Gittele, apporte-moi le second carnet. »
Il se mit à le lire ; il s’agissait, cette fois, de la consignation de tous les ennuis, accidents, de tous les drames ou mauvaises choses dont il avait été victime au cours de l’année écoulée : pertes financières, vols, violence, épidémie ayant décimé son bétail, maladie des enfants, brimades antisémites, le triste florilège d’une vie d’extrême pauvreté dans un coin reculé de Transylvanie à la fin du siècle dernier…
La lecture de ce second carnet achevée, le tavernier se dressa alors et éleva la voix :
« Tu vois, ô mon Dieu, mon bon Dieu, tu vois combien j’ai péché contre toi. L’année dernière j’avais promis d’améliorer mon comportement, mais je n’ai pu tenir mes bonnes résolutions. J’ai cédé à mon mauvais penchant, et j’ai maintes fois transgressé tes mitsvot. »
Puis, élevant encore la voix : « Mais considère, mon Dieu, mon bon Dieu, considère aussi, en cette veille de kippour, que chacun pardonne, et que chacun est pardonné ! Alors je te propose la chose suivante : mettons le passé dernière nous ! J’accepte que tous mes ennuis soient considérés comme une expiation pour tous mes péchés, et toi, dans ta grande bonté, dans ta compassion, tu feras de même ! »
Zussia prit alors les deux carnets, les éleva pour les faire tourner trois fois au-dessus de sa tête, et commença à réciter les formules d’usages : « zé halifati, zé temurati, zé kapparati », « ceci est mon échange, ceci est ma substitution, ceci est mon expiation ».
Le hassid, les yeux écarquillés dans l’ombre, était pétrifié d’étonnement et de ferveur. Il vit distinctement Zussia, le tavernier, jeter alors les carnets dans le feu, où ils consumèrent leur existence avec un petit crépitement de joie. Le signe, sans doute, que son marché avec Dieu, que ses kapparoth avaient été agréées…
Cette histoire, à vrai dire, nous inspire de multiples commentaires.
Sans doute nous faut il commencer par rappeler que cette coutume des kapparoth n’est pas mentionnée dans le Talmud, elle est tardive et a toujours été sujette à controverse. Le Shulkhan Aroukh, dès le 16ème siècle, les a qualifiées sans ambages de « rite stupide » et, une fois n’est pas coutume, le mouvement libéral ne l’a pas contredit…
Une chose demeure toutefois au-delà du rite, c’est la notion de kapparah, « d’expiation », et c’est bien elle que nous invoquerons, demain après-midi par exemple, lorsqu’au cours du rituel de Tashlikh, nous retournerons nos poches, au bord de l’eau, pour nous débarrasser symboliquement de nos péchés. Aussi cette notion de kapparah mérite-t-elle un bref détour explicatif.
Le mot provient d’une racine kaf / pé / resh signifiant « expier, pardonner », mais son sens profond indique l’idée de « couvrir », « recouvrir ». « Couvrir », comme on dit d’un supérieur hiérarchique qu’il « couvre » les agissements d’un subordonné en en faisant son affaire, y compris si les conséquences en sont néfastes. On comprend ainsi comment cette notion de « couvrir », « couvrir le péché », finit par signifier « pardonner ».
A l’aune de ces précisions, que nous inspire cette histoire ?
Une prévention, tout d’abord, qu’elle ne pouvait évidemment anticiper, mais que nous a légué le 20ème siècle : aurions-nous la hutspa, l’audace, pourrions-nous, aujourd’hui, après la Shoah, passer cette sorte de marché forcé avec Dieu, et tel Zussia, plein de malheurs sans doute, mais avec sa dose de bonhomie, de roublardise, lui proposer une sorte de « tope-là » divin : « allez, nous sommes quittes ? »
Il nous semble que le compte, du côté de Dieu, n’y est pas. Que la disproportion du malheur, dont nous ne pouvons comprendre que Dieu en soit la source, ou même le témoin impuissant, ne pourra jamais être la compensation d’aucun péché, aussi grand soit-il.
Mais à vrai dire, l’histoire peut aussi faire l’objet d’une lecture inverse.
Emus par les bons sentiments de Zussia, nous lui attribuons une forme de piété populaire, poignante et finalement sublime. Mais à la réflexion, ce « tope-là » audacieux du tavernier, qui s’instaure en apothicaire comptable de la rétribution divine, n’a-t-il pas un côté frauduleux ? Qu’ont donc à voir ce que fait l’homme, et ce que fait Dieu ? A supposer que la perspective comparative ne soit pas un blasphème, le tavernier met-il vraiment dans la balance tous les éléments qu’appellerait une authentique pesée ? Y inclut-il les bienfaits dont Dieu l’a comblé ? Quant aux choses que lui n’a pas faites, et qu’il aurait pu faire, où passent-elles dans ce calcul « à la louche » du tavernier ? Zussia a beau couler son marchandage dans la forme du rituel, « ceci est ma substitution, ceci est mon expiation », ne conclue-t-il pas prématurément à l’équilibre des parties ?
A vrai dire, l’histoire met plutôt en relief qu’une authentique comparaison serait bien trop vaste pour notre esprit. Que nous plaçions l’accent sur le manquement divin, ou sur les nôtres, il semble même que ce soit ce désir insensé, si humain, de rapprocher deux ordres sans commune mesure, ce que nous faisons et ce que Dieu fait, qui nous mène à une impasse….
Pourtant. Cette impossible symétrie a quelque chose de vrai, car elle nous adresse, en fin de compte, une question simple :
Et nous ? Avons-nous fait le compte ? Avons-nous pris cinq minutes pour rentrer en nous-mêmes, noter ces deux-trois choses « que nous savons de nous », au fil de l’année passée ? C’est ici que la fantasque pesée de Zussia nous fait sentir, pressentir la grandeur de Rosh ha-Shanah.
Nous pressentons que, même si nous n’avons pu remplir nos carnets, le pardon nous sera peut-être accordé. Il ne sera pas si nous ne faisons rien ; mais si nous faisons un peu, si nous commençons cet effort d’introspection face à nous-mêmes, alors le pardon pourra être accordé. Pourquoi ?
Parce que c’est au plus profond de nous-mêmes que Dieu nous trouve. Parce que si Dieu se laisse abuser par notre comptabilité, reconnaissons-le, c’est en toute bienveillance. Dieu est médecin mais il n’est pas apothicaire, et la seule chose dont il a besoin pour toper de sa main divine avec Zussia, avec nous tous, c’est que nous soyons au rendez-vous de nous-même. Tout ce dont il a besoin, ce n’est pas de mathématique, c’est de sentir l’odeur du carnet, la sincérité de l’encre, peut-être la trace de quelques larmes.
Aussi, si ces vieux carnets ont laissé aujourd’hui la place à nos actuels smartphones, tablettes et autre i-pads, alors on me permettra cette image : nous qui les faisons également tournoyer au-dessus de nos têtes pour en tirer le meilleur autoportrait, le meilleur selfie, sorte d’avatar « deux points zéro » de nos antiques kapparoth, ce n’est point-là ce qui est exigé de nous en ce soir de Rosh ha-Shanah. Ce qui est exigé de nous, c’est un autoportrait, sans concession, de nous-mêmes, ce qui est exigé c’est un selfie, mais un selfie de notre âme !
Shanah tova !
« Soyez inscrit, en cette nouvelle année 5775, dans le livre de la vie ! »
Erev Rosh ha-shanah. Mercredi 24 septembre 2014