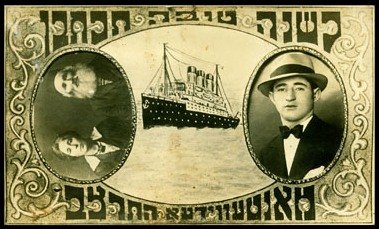Un soir, alors que le rabbin Israël Meïr Kagan -- plus connu sous le nom de Hafets Hayyim, rentrait de la synagogue après les prières de Rosh ha-shanah, il remarqua, installé dans une arrière-cour, un groupe de joyeux compagnons qui tenaient festin. Le rabbin, qui reconnut parmi eux certains de ses fidèles – qu’il connaissait comme de joyeux drilles-- s’approcha d’eux pour leur souhaiter shanah tovah. Sur la table gisaient bon nombre de « cadavres » de bouteilles vides, preuve évidente que cette joyeuse assemblée ne s’était nullement attablée en l’honneur de la fête, mais pour le seul plaisir de festoyer et de s’enivrer.
Lorsqu’il virent que le Hafets Hayyim semblait quelque peu choqué par leur attitude, les fêtards insistèrent pour lui démontrer qu’ils étaient en train de tenir banquet en l’honneur de la nouvelle année ; en fait, expliquèrent-ils, ils souhaitaient organiser ce festin depuis longtemps, mais ils l’avaient repoussé de plusieurs semaines uniquement dans le but de le faire coïncider avec Rosh ha-shanah.
Pour toute réponse, le Hafets Hayyim hocha la tête et leur offrit la parabole suivante :
Il était une fois, commença-t-il, un jeune garçon du nom de Meisel qui avait perdu son père et vivait seule avec sa mère. Il était aimé de tous les gens du shtetl, et connu pour ses dispositions intellectuelles exceptionnelles ; tous lui prédisaient un brillant avenir. Mais parmi ses nombreuses qualités, la plus touchante était sans doute l’affection que Meisel portait à son vieux professeur de talmud, qu’il aimait sans doute comme le père qu’il n’avait pas connu, et pour lequel il était animé d’un souci constant, un dévouement qui forçait l’admiration de tous. Un soir d’hivers, cependant, la tragédie survint. Alors que son vieux professeur rentrait au petit matin d’une nuit d’étude au ḥeder du village, il glissa et chuta en entrant chez lui, et décéda sur le champ – le garçon, absent à cet instant, ne le sut pas.
Les villageois s’assemblèrent et discutèrent de la façon d’annoncer la nouvelle au jeune Meisel sans lui causer un chagrin excessif. L’un des voisins suggéra finalement de lui acheter un beau costume neuf de façon à lui inspirer tout d’abord de la joie, pour ainsi, avec un état d’esprit renouvelé, se sentir plus fort et être capable de recevoir la terrible nouvelle de la mort de son professeur sans s’effondrer.
Cependant, comme aucun villageois n’avait le courage d’annoncer lui-même la nouvelle au jeune garçon, ils décidèrent d’écrire l’annonce de la mort du professeur sur un petit bout papier, qu’ils plièrent et placèrent ensuite dans l’une des poches du costume.
Ici le Hafetz hayyim s’arrêta, pour soupirer profondément: « Imaginez juste, conclut-il, ce que dut ressentir le petit Meisel lorsqu’il reçut son nouveau costume et, à peine quelques minutes plus tard, lorsqu’il découvrit et lut le mot dans sa poche. Et d’ajouter : c’est un devoir religieux d’être joyeux à Rosh ha-shanah pour ainsi ressentir la joie de la fête, mais qui sait quelle sorte de jugement sera enregistré au ciel en ce jour – peut-être la fête n’est-elle qu’un costume, et la poche contient-elle un petit billet avec un message…
L’histoire ne dit pas si les festoyeurs eurent l’appétit coupé, ou s’ils trouvèrent dans cet apologue des dispositions renouvelées pour comprendre le sens de Rosh ha-shanah. A première vue, l’histoire du Ḥafets Ḥayyim exprime un indéniable fond de vérité. Rosh ha-shanah, en effet, présente un double caractère, d’une part un jour de l’an, un jour anniversaire, celui de la création de l’homme, et d’autre part un jour de jugement. Le jour anniversaire serait donc l’aspect joyeux, positif, le « costume », pour ainsi dire, de la fête ; et l’autre aspect, celui du jugement, qui nous est encore masqué, pour n’être scellé qu’au jour de Kippur, serait son pôle plus sombre. L’image dramatique du billet dans la poche, ainsi, prendrait une valeur littéraire tout à fait appropriée.
A bien y réfléchir, cependant, cela ne nous semble pas convaincant ; car plutôt qu’une juste parabole sur la double nature de Rosh ha-shanah, c’est avant tout la lâcheté des villageois qui semble déterminante dans cette histoire ; dès lors que nul n’a le courage d’annoncer la nouvelle au jeune garçon, le stratagème du mot dans la poche nous laisse le sentiment d’une certaine cruauté, transformant une bienveillance initiale en recette pour un désastre psychologique. Si le double aspect du costume et du message semble en effet entretenir quelque rapport formel avec Rosh ha-shanah, il paraît difficile d’en attribuer l’effet dramatique à l’essence-même de la fête.
Qu’avait donc en tête le Ḥafets Ḥayyim en racontant cette histoire ? Cette difficulté posée par la notion de jugement est peut-être finalement la clé, la part de vérité de sa parabole. Car si, dans son récit, le stratagème du costume a simplement pour fonction de retarder le moment de l’annonce, il est parfaitement exact que la notion de jugement, de justice, dans la tradition, est précisément fondée sur cette idée de retardement, d’un délai dans le temps.
Ainsi que l’enseignait Manitou, en effet, la seule façon pour que la personne humaine puisse rencontrer la Loi, face à face à priori implacable, est de faire en sorte que l’homme dispose d’un délai pour se mettre à hauteur du jugement. Rien n’est plus clair pour comprendre cette idée que le modèle du premier jugement de Dieu envers l’homme, celui qui suit l’expulsion d’Adam du jardin d’Eden, où Dieu énonce la sentence en une combinaison grammaticale des plus intéressantes : mot yamut, « mourir tu mourras ». Autrement dit : le verbe « mourir » une première fois à l’infinitif, et une deuxième fois ce même verbe, à la deuxième personne, conjugué au futur.
Qu’est-ce à dire ? Dans l’absolu, le strict jugement, pour l’homme, devrait être « mourir », un pur dictat, sans conjugaison, un jugement qui ne souffre aucune discussion ni aucun aménagement temporel. Mais par un acte de grâce, Dieu nous transforme ce jugement infinitif – et définitif-- en un « tu mourras », autrement dit il invente le temps, nous accorde ce temps pour nous permettre d’acquérir des mérites, une épaisseur, et en une rencontre différée, nous hisser à la hauteur de la justice. Le monde est jugé, rigoureusement, mais par le truchement du temps, l’homme se voit accordé une grâce qui vaut espace de vie, et dignité d’être.
Ainsi, sans doute, s’éclaire la mise en garde du Ḥafets Ḥayyim… Mais que l’on se rassure ; à l’heure où nous attend la dégustation de divers aliments symboliques qui seront les premiers de cette nouvelle année et où, je l’espère, nous attend en nos demeures un digne repas de fête, il n’entre pas dans mes propos d’inventer de fausses poches ni de mauvais lunes de papier.
Soyons simplement conscient que si Rosh ha-shanah, fête de la création humaine, est aussi celle du jugement, ce jugement, pour la 5772ème fois, ne nous est pas donné comme un stratagème, mais comme une chance, une dimension essentielle de notre humanité. Souhaitons-nous ainsi, en ce temps d’introspection et d’examen de nos actes, ce rendez-vous avec la justice et la justesse : car, en fait, nous ne sommes-nous pas créés pour être ensuite jugés. Au contraire, c’est le jugement qui nous est donné de façon première pour nous permettre d’accéder à la création, et à travers la dimension du temps, dépasser notre statut de créature pour mériter enfin le nom d’homme.
Soyez inscrits dans le livre de la vie.
Shanah tovah, u-metuqagh.