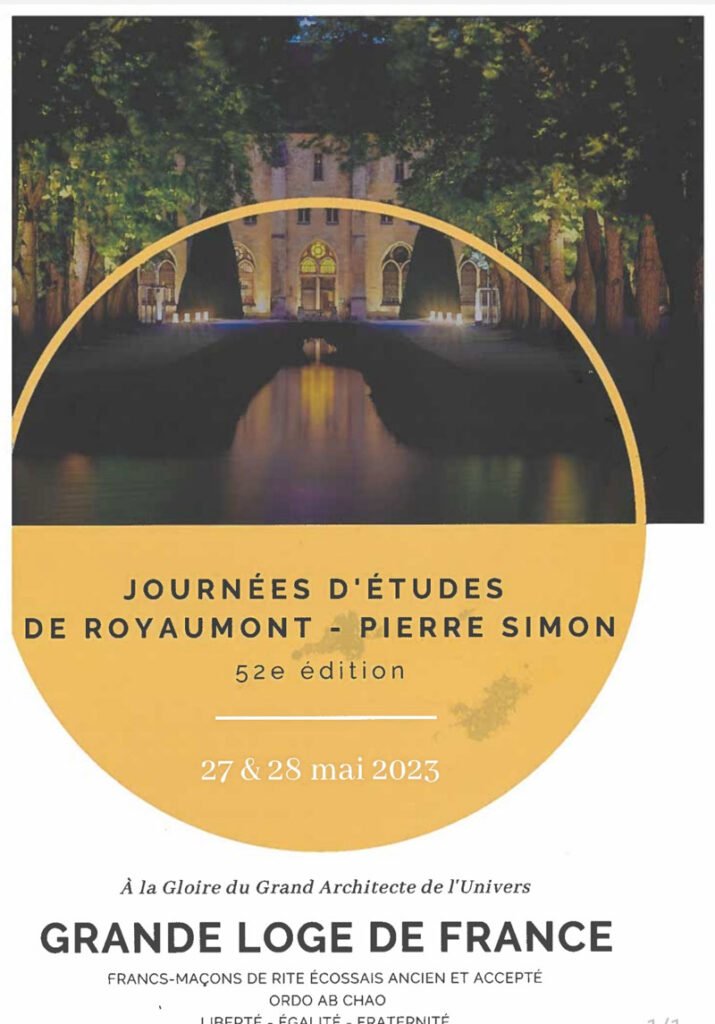Métaphysique de la Loi
Oui ou non, sommes-nous obligés à quoi que ce soit dans le monde ?
La conscience post-moderne se signale par un trait remarquable : la difficulté à trouver intéressant de se soumettre à une autorité, à des valeurs, ou de reconnaître la Loi comme une possibilité de perfectionnement. La Loi est par définition une anti-liberté, et la liberté le nec plus ultra de notre activisme dans la société et dans le monde. S’il est une loi valable, nous a martelé Kant, elle ne peut être que celle que nous nous donnons à nous-même – dispositif astucieux, qui nous dispense de toute reconnaissance, de toute dette envers une cause extérieure ou antérieure à nos souveraines consciences. Quitte à obéir, que ce soit à nous même ! -- notre liberté sera de surcroît notre propre hommage…
La normativité, le « prescriptif », la Loi ont été pendant des siècles des figures majeures de la vie de l’esprit – lorsqu’intelligence et spiritualité faisaient encore bon ménage. « La soumission est la base du perfectionnement » affirmait hier encore Auguste Comte -- songeons combien cette phrase nous fait frémir aujourd’hui ! La sujétion au droit fait difficulté à la conscience de l’homme moderne. L’obligeance, l’obligation, le devoir sont considérés comme de vieilles lunes judéo-chrétiennes, à rejeter comme autant d’expressions d’une anthropologie dépassée.
Que s’est-il passé ? Si la Loi importait dans le monde ancien, c’est parce qu’elle était perçue comme un mode global d’appréhension de l’univers. Là où l’expérience quotidienne glanait quelques données sur le monde – « expérience » qui avant Kepler et Galilée, n’était pas thématisée comme telle -- la Loi, elle, exprimait les vérités divines et scripturaires généreusement diligentées par les perfections du cosmos. On subodorait, avant Descartes, les pouvoirs du sujet, mais la grande pourvoyeuse de sens pour la vie humaine, c’était la Loi : avant que de valoir obéissance, elle était reconnaissance, réceptrice et conductrice de vérité.
La modernité a fait table rase – du moins a-t-elle souhaité le faire. Posant l’individu au centre du système, celui-ci est apparu non plus lesté de devoirs, mais désormais pourvu de droits et de pouvoirs, sanglés par deux attributs majeurs : la réflexivité et l’autonomie. Hegel a rappelé combien la subjectivité était au fondement de la Modernité. « Le droit de la particularité du sujet à trouver sa satisfaction ou, ce qui revient au même, le droit de la liberté subjective, constitue le point critique et central qui marque la différence entre les temps modernes et l’Antiquité. »[1] La geste inaugurale en revient à Descartes qui, par son seul et puissant « je pense, je suis », érige la réflexivité du « sujet » en forteresse. Le sujet moderne se boucle sur lui-même dans un dispositif désormais « réflexif » ; loin des cieux, son expérience ne dépendra que de sa propre conscience. Désormais, le sujet post-moderne se pense libre, riche d’autant de libertés qu’il a de sujets d’intérêt. Aujourd’hui dépassé par l’obésité informative mais « connecté », il a décrété que la Loi ne le juge plus – il la juge, en retour, inaccessible et inutile.
On pourra se demander : de quelle loi parle-t-on ? Non pas de la loi civile. Ni d’ailleurs de la loi religieuse. La Loi dont je veux parler ici est un objet métaphysique : la Loi derrière toutes les lois. L’idée de loi, la droiture, cette logique du juste dont l’homme, au-delà des résistances de sa conscience, se sait l’obligé, et qu’il sait exister quand-bien même il ne la respecte pas. Autrement dit, la Loi à son véritable niveau de dignité : comme expression d’une vision du monde et d’une métaphysique. Georgio Agamben, dans Qu'est-ce que le commandement, a relevé combien la pensée occidentale avait opéré en ses débuts un choix crucial entre prescriptif et descriptif. Optant pour la description de l’être à la lumière de la raison, le commandement et la Loi se sont vus relégués comme des objets intellectuels de dignité seconde. L’histoire postérieure de la pensée occidentale n'a fait que radicaliser cette dépréciation de la loi. Spinoza ira jusqu’à lui dénier toute portée intellectuelle, pour la réduire à un dispositif pratique tout juste bon à générer de l’obéissance.
Tragique oubli, regrettable impensé, car la Loi, une « Loi-vision » porteuse de « vérités », exprimant une ontologie, une métaphysique pleine et entière a bien sûr existé, et existe toujours. C’est celle dont la tradition juive, sous le nom de Torah, a gardé la mémoire, et c’est d’ailleurs celle que je prendrai en référence, en filigrane, de ce bref exposé, pour envisager quelques questions de « métaphysique normative » : Au nom de quoi la loi « oblige-t-elle » ? A supposer une source d’obligation, comment fonctionne sa légitimité ? Qu’est-ce qui peut justifier que l’on obéisse à quelque chose ?
Oui, la Loi fut, et constitue encore un projet métaphysique. Un ordre d’intelligibilité à la dignité propre. Tout autant que la connaissance philosophique, par le logos, offre une réponse proportionnée à l’intuition grecque de « l’être », la Loi exprime la réponse adaptée à ce que la mentalité hébraïque perçoit du monde tel qu’il se déploie dans la Bible.
La Loi comme métaphysique de la création
La lecture de la Bible, dès ses premières lignes, suscite une question : pourquoi le récit nous présente-t-il la Création comme un fait de langage ? L’élément le plus étonnant de la Genèse, en effet, consiste en ce que la création de chaque élément est précédée d’un acte linguistique. « Qu’elle soit ! ». Et la chose est. Vision inédite que cette précédence du langage. Ne serait-il pas plus évident pour Dieu, que l’on suppose volontiers omnipotent, de se livrer sans détour à une Création muette, et plénière ? Dieu pourrait simplement vouloir, et créer. Qu’a-t-il besoin de parler ?
Premier marketing de l’humanité, plaisantera-t-on, mais surtout : authentique vision du monde. Dans la Genèse, Dieu parle en quelque sorte pour ne rien dire, mais pour faire. Il SE dit qu’il va faire (à qui d’autre que lui-même peut-il dire cela ?), et il fait. Thèse métaphysique majeure : c’est la parole qui est la première. Et comme cette parole est un ordre, une injonction, c’est la Loi qui est première. Le « devoir-être » précède « l’être ». Telle est la vibration fulgurante, première, de la vision hébraïque.
Le statut de l’être ne s’apprécie que relativement à la primauté de la parole. En posant l’être comme consécutif à un acte de parole, la grande invention de la Bible confère aux choses non seulement la dimension ontologique de l’existence, mais bien davantage, les dote d’un statut de « fait ». Expliquons ceci. A l’inverse de la vision grecque pour qui la donnée première est « l’intensité » de l’être, ce qui induit pour projet de le décrire, le mettre à distance et se l’approprier par la médiation du concept, l’être hébraïque se voit d’emblée « secondarisé » par le langage. L’être du monde, chaque élément créé, en effet, ne devient pas immédiatement et de manière pleine ce qu’il était pensé dans la volonté du créateur. Il reçoit son existence de manière seconde, uniquement après qu’une injonction, un « appel à être » ait eu lieu, tant et si bien que le statut de l’être créé prend la valeur, légèrement hybride, d’un « fait » -- expression à entendre comme une validation, comme le raccourci de « voilà, c’est fait ». Pour la vision biblique, l’être n’est pas ce « bloc » premier et incontournable comme chez Parménide, il n’existe que comme « fait », comme « accompli », relativement et postérieurement à un Dit premier, qui se trouve être une injonction – où s’entend les premières notes de la Loi.
C’est au cœur de la Création que la Loi trouve ainsi son ancrage et sa portée métaphysique. Enregistrant la donnée de la primauté de la parole sur le seul niveau de l’être, la Loi se fait conductrice de ce décalage entre le « devoir être » et « l’être ». Le souffle de Dieu « planait à la surface des eaux », nous dit le verset Gen. 1, 2 ; autrement dit, le logos n’est pas comme pour les grecs dans les choses, dans le kosmos tel un logiciel intérieur (« logos inside ») dont nous pourrions extraire la « raison » par notre propre langage. Pour la Bible, la parole volète toujours à la surface de l’être, première et libre, elle darde sur lui la constante possibilité du « devoir être », exprimant en quelque sorte un « droit de regard » qui deviendra le « regard du droit ». Tel est l’ancrage métaphysique de la Loi. Présente au cœur de la Création, la Loi se déploiera dans la pensée des Sages comme vouée à la mémoire du sublime écho de ce que « Dieu appela et le monde fut ».
Conséquence annexe mais intéressante : la précédence de la parole dans la Genèse n’implique nullement une perspective d’explication causale du monde, comme nous y habitue la pensée grecque, où la parole serait la cause de l’être. Outre le fait d’ancrer le réel dans un statut de « fait », la primauté du langage crée surtout la possibilité d’une polarisation constante du réel par la Loi – le monde biblique est un monde jugé. Dans cette perspective, l’être n’est pas seulement un univers de substances pourvues d’une « nature » (physis), qu’une activité intellectuelle pourrait correctement déterminer par son attirail de catégories, d’attributs, de syllogismes… Entendons-nous bien : la tradition ne renonce aucunement à la libido sciendi, mais simplement, la teneur métaphysique de la Loi l’oriente vers un autre projet que la seule activité de connaissance. Si l’être est en constante tension du « devoir être » exercé par la parole, alors il sera appelé à se voir polarisé selon les choix éthiques de la personne humaine. Car si la Loi existe, encore faut-il que l’homme la rencontre.
Rencontrer la Loi – Métaphysique de la responsabilité
C’est au jardin d’Eden que l’homme, pour l’heure au stade de l’Adam, entre en relation avec la Loi. Nul romantisme dans le récit de cette rencontre, mais ce fameux réalisme de la Bible qui s’autorise à imaginer, d’emblée, que l’homme puisse ne jamais rencontrer la Loi.
A ce qu’il semble, le paradis n’est pas de tout repos pour Adam. Trop d’arbres – arbre de vie, arbre de connaissance – trop de choses à « gérer », dirait la prose contemporaine. La nomination des animaux, proposée par Dieu comme remède au solipsisme de l’homme, propulse celui-ci dans une série d’embarras. Son endormissement, l’apparition d’une créature « autre », « aide contre lui »[2], et l’affaire du fruit défendu : autant de « situations » emboîtées les uns dans les autres qui ne sont que le prélude à sa fuite ; mais aussi à sa rencontre avec la Loi…
Pour en saisir le caractère fondateur, ayons à l’esprit que la séquence du Jardin d’Eden n’est rien d’autre que la première phase de la grande entreprise de démythologisation de la Bible, en l’occurrence la constitution de l’autonomie humaine. Scission avec la cause première, éloignement de la source, délit de fuite devant le Créateur : l’homme, au Gan Eden, devient une créature séparée. Mieux : il devient lui-même causal. Auparavant semblable à l’ange, perfusé à l’omnipotence divine, l’homme n’était à l’initiative de rien, et rien ne pouvait naître de ce qu’il faisait. Dans le vaste placenta paradisiaque, Adam vit d’éternité sans même comprendre ce qu’est le temps ; son comportement n’est qu’une nature, confondue en Dieu, et sans effet sur la réalité.
La solitude est diagnostiquée, mais la joyeuse parade de nomination des animaux n’y pourvoit pas : il faut anesthésier. Adam est donc endormi, et de son « côté » surgit Eve. Eve sera donc l’ouverture, la possibilité de l’altérité au sein du genre humain. Problème de solitude réglé, mais sacrée complication… Les arbres entrent à nouveau en jeu, et un fruit défendu plus tard, la totale mais lénifiante harmonie d’Adam vole en éclat. Sa transgression produit cependant quelque chose d’extraordinaire : une scission entre sa nature et son comportement. Entre ce qu’il est et ce qu’il va désormais devoir faire. Séparé, arraché au « bain total de Dieu », Adam reçoit une enveloppe corporelle qui consacre son autonomie.
Alors, la Loi rencontre l’homme.
« Où es-tu ? » tonne Dieu à l’attention d’Adam.
La question le prend totalement de court. Elle provoque sa fuite. Avant même que de le laisser acquérir des « expériences » au contact du monde, cette incise de la Loi somme d’emblée l’humain de répondre à une parole. Ce « où » lui intime précisément d’avoir « lieu d’être ». Ici, l’hébreu nous montre que la grammaire est chose sérieuse. La première leçon de la question divine tient dans sa forme grammaticale : « ayéka ? » (« Ayé », en hébreu, signifie « où ?, et le suffixe « -ka » indique la deuxième personne du singulier). La traduction courante rend la divine interrogation par « où es-tu ? », mais en la traduisant littéralement, son sens est plus pointu, de l’ordre de « [et] ton ‘’où’’ » ?, voire, en poussant la pointe lacanienne : « ton ‘’où’’ à toi, qu’en est-il ? »
A minima, le « tu » de la question révèle le désir d’un « je » aux yeux de Dieu. Ce « je », l’homme n’avait jamais osé l’imaginer pour lui-même. Au cœur du bain amniotique de l’Eden, ce « tu » lui offre l’opportunité d’une rupture : s’arracher à la douce factualité du monde pour devenir « sujet de droit », et ainsi accéder au « droit d’être sujet ». Le « tu » biblique instaure en somme toutes les puissances de ce qu’énonce Wittgenstein dans le Tractatus : « Le sujet n’appartient pas au monde, mais il est une limite du monde … »[3]
Le « où ? » de la question, quant à lui, délivre également un message, d’une originalité si distinctive qu’elle pourrait exprimer à elle seule la partition entre pensée juive et pensée grecque. Le fait que le monde soit en perpétuel mouvement avait constitué pour les précurseurs de la philosophie, les physiologues ioniens, une énigme première. Leur découverte fut l’archê, le « principe » : moyennant sagacité et méthode, le réel, inlassable pourvoyeur de pluralités, pouvait être « réduit », compris en se « pliant » à une notion première. Le « Ayéka » biblique, quant à lui, oriente la quête humaine vers une toute autre direction. C’est la question de la « place » qu’elle pose. Sa « place » dans l’être, le « jeu » dont l’individu doit disposer pour desserrer l’étreinte du réel, faire valoir son unicité, son absolue différence.
Autrement dit, la métaphysique biblique ne se porte pas de manière première vers une ontologie de l’être, vers la quête de principes de la nature ou de substances, vers des « quoi » pourvoyeurs de concept. Il n’y a « pas de quoi », pour la Bible, qui vaille de façon première. Il y a avant tout la question du « qui » : « qui » me donne (le monde) ? « Qui » me parle ? Et surtout : « qui » dois-je être pour pouvoir recevoir ? Quel « Je » dois-je instituer pour être à la hauteur de ce don de l’être ? La rencontre de l’homme avec la Loi inscrit celui-ci dans la question du rapport à sa propre source. Primauté de la reconnaissance sur la seule connaissance, qui n’appelle pas une réponse « descriptive », mais une direction de vie : se constituer en « qui », en « personne humaine », en « je » pour se hisser au niveau de la question.
Scandale de l’hétéronomie que ce « tu » divin initial ! clameront certains. Cette question de la Loi, l’homme ne peut-il donc pas la penser de son propre chef ? N’y aurait-il pas de « Dieu qui vient à l’idée », comme chez Levinas ? Ou « de l’idée de l’infini en nous » comme chez Descartes ? Rien de cela, en effet. Par la soudaineté de sa question (« Où es-tu ? »), avant même la « pression des faits » chère aux empiristes, Dieu court-circuite toute velléité de cogitation humaine, et nous force à répondre. Cette réponse, il ne nous est pas demandé de la fonder sur un savoir que nous aurions eu le temps de constituer, mais de la délivrer directement, en tant que personne.
Loi profondément anti-fichtéenne ! Le sujet ne se fonde pas lui-même, il n’est fondé que parce qu’il est adressé. Si le sujet n’est pas fondé, c’est qu’il est révélé. Kafka l’avait compris, qui prophétisait : « Du bist du Aufgabe » : « Tu es-toi-même la tâche »[4].
La Loi – Une métaphysique de la connaissance
La culture occidentale a déprécié la Loi en lui déniant toute légitimité métaphysique. Avant que les penseurs « modernes », Spinoza et Kant en tête, ne s’en fassent les théoriciens, cette dépréciation s’est nourrie d’une ignorance envers une spécificité il est vrai étonnante du droit hébraïque : alors que dans la plupart des civilisations la loi est avant tout prescriptrice de régulations pour la société, elle n’a jamais eu cette seule fonction dans l’histoire juive. Les Sages n’ont certes pas manqué d’irriguer le quotidien de leurs considérations légales, mais la « halakhah », la « loi juive » que l’on rencontre dans les pages du Talmud se déploie avant tout comme une problématique de connaissance, matière à penser et à discuter.
La Loi, ainsi, légifère, mais aussi se discute. La Loi s’étudie, non pour être simplement connue, ou mieux connue -- mais pour se vivre comme une problématique de connaissance. C’est l’une des conséquences étonnantes de l’ancrage métaphysique de la Loi, témoin de la dialectique du « devoir être » et de l’être. C’est à l’origine-même de l’expérience hébraïque du monde qu’il nous faut retourner pour en comprendre la raison : au Jardin d’Eden.
Le philosophe Hans Blumenberg développe la théorie selon laquelle l’homme a besoin de la raison pour compenser sa pauvreté d’être[5] ; la raison, affirme-t-il, aurait pour fonction principale de structurer sa visibilité dans le monde. Cette idée offre un bon point de départ pour notre sujet, le Jardin d’Eden et son épisode principal, le fruit défendu. On s’en souvient, il est deux arbres remarquables au Jardin d’Eden : l’arbre de la vie, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal[6]. Ne point manger de ses fruits est la première injonction de toute la Bible donnée à l’être humain ; sa transgression sera suivie de la question divine « où es-tu ? », que nous avons commentée.
En écho à Blumenberg, je pense volontiers que le développement de l’activité symbolique chez l’homme peut être vu comme la compensation du fait qu’il n’a pas de substance propre. L’expression « créé à l’image de Dieu »[7] signifie en effet pour l’homme que sa substance ne lui est pas donnée comme une « nature », quelque chose qui le définirait ou le déterminerait à un comportement particulier. L’expression « à l’image de Dieu » nous enseigne que s’il est quelque substance à l’homme, celle-ci sera plutôt corrélée à la représentation qu’il aura, non de Dieu lui-même, mais de sa capacité à se concevoir en lien avec Dieu. Cette représentation, le curseur de cette « image divine », dépend donc de son libre-arbitre. Ce que décrit la séquence du Jardin Eden, c’est l’attirance d’Adam, être sans substance propre, pour la science divine incarnée par cet « arbre de la connaissance du bien et du mal », la tentative d’en siphonner la connaissance pour lui-même, et son échec. Lorsque Blumenberg décrit l’activité culturelle comme une vaste entreprise de mise à distance et de révolte contre « l’absolutisme de la réalité »[8], je le suis volontiers, mais avec la perspective suivante : si l’activité symbolique est cette capacité de la conscience à se mettre à distance des choses pour en concevoir des « objets »[9], des objets de connaissance, j’en rapproche la thématique à ce qui me semble être la grande leçon du Jardin d’Eden : le « connaître » n’a pu voir le jour que par l’échec d’Adam à s’approprier la science divine.
La possibilité de la connaissance comme activité, en effet, doit tout à cette prétention battue en brèche. Après cet échec, « connaître » revient désormais à rechercher le « vrai et le faux », mais également le « bien et le mal » comme une dimension de problème distincte. Si l’on revient à la formulation complète de l’expression hébraïque, à savoir l’arbre « de la connaissance du bien et du mal » (et non « l’arbre de la connaissance » uniquement), le seul énoncé du syntagme nous rend limpide la scission qui s’opère. L’arbre nous revient pour ainsi dire en pièces détachées : l’activité de « connaissance » d’une part, la conscience du « bien et du mal » d’autre part.
Parce que la recherche du vrai et le faux est une réduction, un substitut de l’ambition de la « science divine », l’homme aura désormais recours aux signifiants, aux concepts, à des notions un tant soit peu rigides pour construire son identité, pallier son absence de substance, se stabiliser dans le rôle de sujet connaissant.
Mais ceci n’est que le premier aspect. Car si l’on tire tout le suc de cet épisode, le texte nous dit que Dieu échoue d’emblée dans sa souveraineté ! Son premier ordre n’est tout simplement pas obéi… Audace inouïe, savoureux réalisme de la Bible que d’énoncer le risque premier d’une Loi jouant sur l’extériorité des consciences et des corps : tout simplement, la désobéissance…
L’expérience première de la Loi est la transgression – il le fallait. Pour l’homme, celle-ci structure son univers par la scission entre monde de la vérité et monde des valeurs. Mais si l’on adopte cette fois le « point de vue de Dieu », l’autre point majeur de cet épisode tient à ce que l’échec de son injonction réoriente de manière décisive le statut de la Loi. D’une affaire de souveraineté, celle-ci devient une problématique de connaissance. Suite à ce ratage arboricole, le droit perd son statut d’expression du pouvoir, pour se redéployer en prescripteur d’un rapport à la connaissance[10]. C’est aussi cela que signifie le « où es-tu ? » : la forme injonctive se redéploye en une dynamique de la question. Le fiasco autour de l’arbre de la connaissance du bien et du mal signe donc l’arrêt d’un fantasme, celui d’une obéissance directe à Dieu. Adam n’a plus à être sous perfusion divine ; c’est sa désobéissance qui donne le coup d’envoi à la transformation de la Loi en problématique de connaissance.
Nous voici
Loi dépositaire d’une vision métaphysique de la Création où la parole est première, où celle-ci, à la perpendiculaire de l’être, polarise le réel sous le regard du « devoir-être » ; Loi conductrice d’une métaphysique de la responsabilité humaine, soucieuse des « qui » tout autant que des « quoi » du monde ; Loi matière à discussion et à étude : la Loi, avant que de se décliner en systèmes juridiques de telle ou telle société, exprime un ordre d’intelligibilité propre, une ontologie et une métaphysique. Si la conscience occidentale a emprunté la voie de l’idéalité et de la certitude vis-à-vis du monde, la conscience hébraïque a quant à elle exploré le potentiel d’une Loi pleinement métaphysique : un chemin qui cherche à poser un « je » responsable devant l’altérité radicale, et « obligeante » de Dieu.
« Il se pourrait que nous ne soyons plus jamais capables de comprendre, c’est-à-dire de penser ou d’exprimer, les choses que nous sommes capables de faire », prophétisait Hannah Arendt[11]. C’est à la hauteur de ce défi, face à la confusion et aux confusions, que la Loi rappelle toute sa pertinence. Tout n’est pas à comprendre dans l’existence, et ce peut être sagesse que de ne pas chercher à placer de la connaissance là où il y faut de la reconnaissance. L’intelligence n’est pas tout, ou alors elle passe aussi par le silence, et par la modestie du témoignage.
La Loi nous invite aux deux. A l’intelligence de comprendre, elle ajoute la responsabilité de témoigner. A la juste place de l’idée, elle joint la tension des valeurs. « L’âme n’est pas là où elle est, elle est là où elle aime », disait Schelling. Le « où es-tu ? », de même, exige de nous une attention un peu plus fine, plus poète, plus oublieuse de soi-même pour être entendue. Ce que la Loi propose à l’intuition, ce n’est pas de chercher à décrire l’espace où l’ego se trouve, mais à risquer l’amour, à poser un « je » qui réponde « Hinéni » : « me voici ! ».
Yann Boissière / « Métaphysique de la loi » – Revue GLDF
Texte lié à la conférence de l’Abbaye de Royaumont – Dimanche 31 mai 2020
[1] G. W. F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, # 124, trad. R. Derathé, Paris, vrin, 1993, p. 163 ; cité par Myriam Revault d’Allones, La Crise sans fin. Essai sur l’expérience moderne du temps, Editions du Seuil, Paris, 2012, p. 83.
[2] Gen. 2, 18. Le verset traduit couramment « une aide digne de lui », mais l’hébreu dit bel et bien « en face de lui », voire « contre lui. »
[3] L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 5.6.3.2.
[4] Cf. Raphaël Lellouche, Difficile Levinas. Peut-on ne pas être lévinassien ?, L’Eclat, Paris, 2006, p. 77.
[5] Olivier Müller, « Comment l’homme est-il possible ? », in Denis Trierweiler (coord.), Hans Blumenberg. Anthropologie philosophique, Presses Universitaires de France, Paris, 2010, p. 70.
[6] Gen. 2, 9.
[7] Gen. 1, 26.
[8] Cf. Jean-Claude Monod, Hans Blumenberg, Editions Belin, Paris, 2007, p. 14 ; cf. aussi Odo Marquard, « Entlastung von Absoluten », in F. J. Wetz & H. Timm (éd.), Die Kunst des Überlebens, Suhrkampf Verlag, Francfort/Main, 1999, p. 20.
[9] Cf. Jean-Claude Monod, Hans Blumenberg, Editions Belin, Paris, 2007, p. 18.
[10] Bon développement de cette idée in Lionel Panafit, « La halakha comme problématique de connaissance », in ALVAREZ-PEREYRE, Frank, PANAFIT, Lionel (dir.), Le Droit interne hébraïque, Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2004, p. 7-56 [p. 35].
[11] Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne.