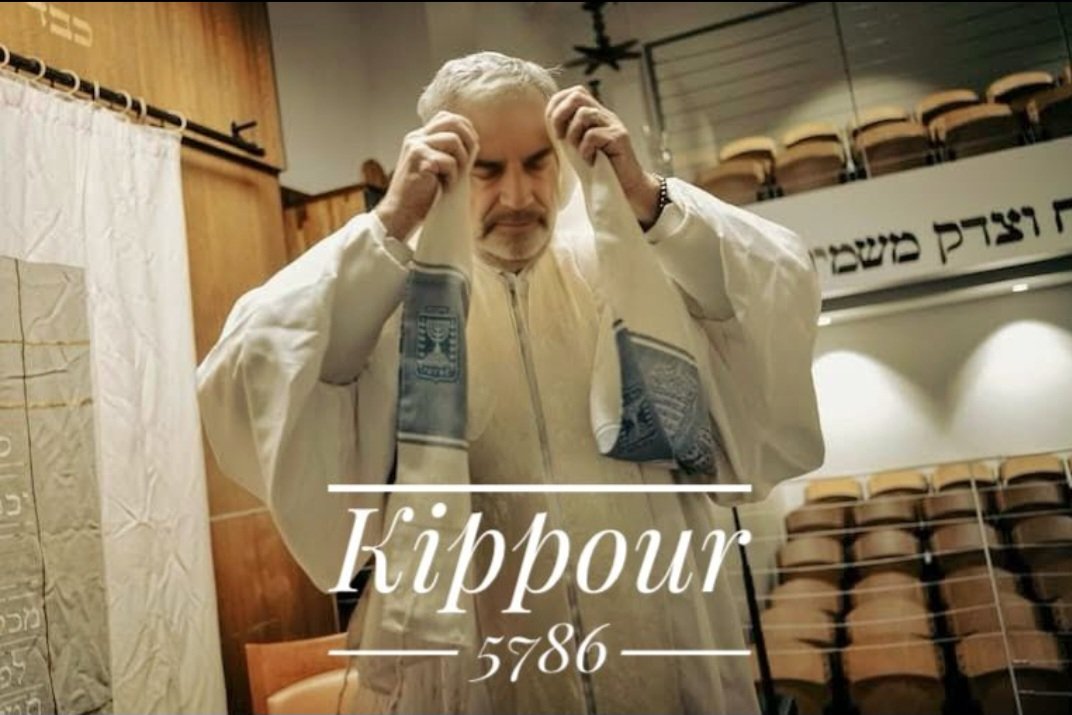
David est furieux. Il a confié à Schmouel, un tailleur qu’on lui a recommandé, le soin de lui confectionner sur mesure trois pantalons blancs pour Rosh ha-Shanah, des pantalons de bonne coupe, dans un beau tissu qu’il a lui-même fourni. Et il s’y est pris à l’avance, pratiquement trois mois avant, pour sécuriser l’affaire, mais voilà que Rosh ha-Shanah approche, et David n’a toujours rien vu venir, il ne dispose toujours pas du moindre pantalon…
Passablement excédé, il déboule dans la boutique de Schmouel, et l’invective en ses termes : « Voilà trois mois que je vous ai fourni le tissu, trois mois que je vous ai commandé trois pauvres pantalons, et toujours rien ! C’est un scandale ! Et franchement, je ne comprends pas… Dieu a créé le monde en six jours, et vous, en trois mois, vous êtes infichu de faire un pantalon !
Devant la justesse de la charge, Schmouel a l’air désemparé. En même temps, on sent le professionnel ébranlé -- ou plus exactement, un brin vexé. Passé le moment de choc, notre tailleur se rengorge, et d’une voix où la fierté blessée fait place à l’indignation, finit par articuler : « Oui, sans doute, Dieu a créé le monde en six jours, mais sans vouloir offusquer qui que ce soit, regardez le monde, et regardez mes pantalons… »
A voir le monde et son actualité, ne serions-nous pas enclin à donner raison à notre tailleur ? Un passage du Talmud, que l’on raconte en général à Rosh ha-Shanah, s’interroge dans la même veine : l’homme méritait-il d’être créé ? La réponse, on la connaît, dit que non, mais le passage ajoute tout de même : « puisqu’il a été créé malgré tout, qu’il fasse de son mieux pour être vertueux… ». Cette question revient aujourd’hui avec une pertinence accrue. Une amie m’écrivait, hier, « Cher Yann, quand on regarde l’état du monde, la violence, l’antisémitisme, pouvez-vous me dire ce que fêtons-nous réellement aujourd’hui ? »… Sur le moment, la concision et la justesse de la question m’ont laissé sans voix… « Ce n'est pas l'heure du chant mais du balbutiement », écrivait le poète Octavio Paz à son ami Roberto Juarroz[1]. Eh bien, chers amis, ce sermon est peut-être tout simplement, balbutiante, ma tentative de réponse…
De quoi avons-nous besoin, aujourd’hui ?
Probablement de douceur, d’apaisement. D'un peu de compassion, sans doute. Et certainement, de beaucoup de lucidité. La spiritualité et la raison, les deux fondements qui structurent l’éducation et le processus de civilisation de l’homme et de son humanité, sont attaqués de toutes parts aujourd’hui. « Si grand, et pourtant si mal élevé », persiflait Talleyrand à propos de Napoléon. Oui, la spiritualité, censée nous élever, se voit sans cesse battue en brèche devant la force déployée par les plus impolis et les plus violents. La raison, quant à elle, est submergée par les innombrables flottilles de la haine, de la subjectivité à tout crin, et des boycotts de tout compromis et de toute compassion, « la peste de l’émotion », comme le formulait le psychiatre Wilhem Reich… Oui, ce monde, devenu quasi-illisible, nous déçoit sans cesse par ses futilités et ses arrogances, et nous stupéfie, chaque jour, par ses dépassements de l’insupportable et de l’inadmissible…
En d’autres termes, ce monde est à la fois trop dur, trop intransigeant, et trop poreux, trop mou, trop relativiste. Trop dur, il nous malmène par ses injustices répétées. Trop mou, trop inconsistant, nous avons du mal à y trouver un sens, à y trouver notre place. Eh bien précisément, face à ce monde dont les pôles extrêmes s’ingénient à nous déposséder de notre humanité, Kippur propose deux verbes-clés, deux actions-clés pour nous permettre de faire face, de faire sens, et de se refaire une dignité. Face à la dureté du monde : se plier. Face à son inconsistance : se tenir. « L’avenir, disait Saint-Exupéry, il ne suffit pas de le prévoir, il faut le permettre ». Voyons maintenant quelles portes ouvrent ces deux clés de notre résilience…
Se plier, tout d’abord. Entendons-nous bien. Il ne s'agit pas tant de se plier à une règle, à une discipline, que de se plier soi-même… Oui, mais devant qui, devant quoi ? Devant la dureté du monde, décrite ainsi par Camus : « s’apercevoir que le monde est « épais », entrevoir à quel point une pierre est étrangère, nous est irréductible, avec quelle intensité la nature, un paysage peut nous nier … l’hostilité primitive du monde, à travers les millénaires, remontent vers nous. »[2] Mais alors, comment se plier ? Par l'une des plus belles inventions du judaïsme : la « bénédiction », la berakhah. La bénédiction, c’est tout d’abord une vision, la capacité à voir dans une chose quelconque, quelque chose d'autre, un potentiel à venir, autrement dit embrasser la poétique perspective de René Char : « Aujourd’hui est un tigre, demain verra son bond »… Cette croissance entrevue, toutefois, n’est rendue possible que par le second aspect de la berakhah, de la bénédiction : le fait de se plier, justement…
Pour le comprendre, il nous faut rappeler que le mot berakhah, « bénédiction », a la même racine que le mot berekh, le « genou »… De fait, il existe un lien entre le genou et la bénédiction, que la pratique religieuse a noué par le geste de la « génuflexion » : fléchir, se « plier » humblement devant notre Créateur. Envisageons, toutefois, cette « pliure » de manière plus radicale : la bénédiction serait tout entière un art de « plier » le réel. L’exemple d’un ruban de papier nous éclairera ici. Considérons ses deux points les plus éloignés, situés chacun à un bout du ruban… A plat, ces deux points, qui font pourtant partie du même espace, s’ignorent totalement, ils ne se « voient » pas, et ils n’ont rien à se dire…Courbez maintenant le ruban sur lui-même de manière à faire une boucle : nos deux points, autrefois extrémités, se touchent désormais, et constituent même le point de jonction de la boucle. Mieux : ce pliage, cette courbure a pour conséquence remarquable de créer un espace totalement nouveau pour le ruban, avec de nouveaux angles de regard sur lui-même -- entre tous les points désormais situés du côté intérieur de la boucle. La pliure, la courbure a créé un horizon intérieur de visibilité et, pourrait-on dire, il a créé une conscience, une intériorité…
Deux portions d’un même réel, étrangères au départ l’une à l’autre, et désormais en regard et en dialogue : il en va exactement de même de la bénédiction ! Comme la feuille pliée sur elle-même, la bénédiction est un art de plier le monde, une sorte d’origami du réel. Celui-ci, dur, intraitable, ne se raidit-il pas sans cesse devant nos tentatives de prédations ? Par notre propre courbure, par notre mise en modestie, par la rémission de notre volontarisme, la bénédiction fissure le bloc du réel, instaure un « court-circuit » dans le causal, le routinier, le recroquevillé. Miracle de Kippour : l’humilité, cœur de la bénédiction, devient facteur de créativité, de croissance et de richesse !
Se plier, tout d’abord. Mais aussi, se tenir.
La seconde clé de Kippur, c’est la qedushah, la « sainteté », dont on sait qu’elle veut dire « séparation », mais dont la force de résilience s’éclaire bien davantage lorsqu’on la place en regard de son opposé, le mot « ‘hol », qui signifie « profane ». Qui signifie « profane », mais aussi… « sable » !
Ce sable, le judaïsme le connaît depuis toujours… Il est aussi celui de Nietzsche, grand déconstructeur devant l’Eternel mais avant tout métaphysicien, qui prophétisait : « Ne prenons-nous pas le plus court chemin pour transformer l’humanité en sable ? »[3] Le philosophe Jean-François Mattéi commente : cet ensablement de l’homme exprime sa dévastation. « Devastare », en latin, c’est précisément « rendre désert » … de sorte que la dévastation est l’action d’un homme qui se déserte lui-même de lui-même et du monde. »[4] Ainsi, face à la « qedushah », à la « sainteté », le séparé qui se tient par lui-même, se profile l’ombre du « profane », du « sable », de ce qui file entre les doigts, de ce qui ne tient pas. Magnifique évocation, là aussi, de Kundera, dans son roman La Plaisanterie : « Nous vivions Lucie et moi dans un monde dévasté ; et faute d’avoir su le prendre en pitié, nous nous en étions détournés, aggravant ainsi et son malheur et le nôtre. »[5]
Cette opposition au sable, à l’ensablement de nos vies, est peut-être la meilleure définition de l’espérance… Au risque d’émiettement que propose le monde à chaque instant, il s’agit d’affirmer notre qedushah, la « sainteté » de nos vies, autrement dit l’effort pour se « tenir ». Face à la machine à balles de la réalité, qui à tout propos tente de nous réduire à l’injonction de choix binaires, « Tu achètes ? », « Tu cautionnes ? Tu t’opposes ? », il s’agit de tenir placidement, sans honte ni arrogance, la colonne verticale de ce que je suis, de ce que Dieu m’a donné. Ne pas s'écrouler, ne pas se laisser dissoudre dans la confusion de monde, oui, je vois ici une définition très simple et très puissante de l’espérance, que j’aime à formuler en détournant les mots de Camus : « dire oui à la part précieuse de soi-même »[6].
Pourquoi apprend-on à compter sur ses doigts ? demandait Rabbi Yohanan. Parce qu’il faut avant tout commencer par compter sur soi… Kippour nous demande de savoir compter jusqu’à deux. Se plier, se tenir. Grâce à ces deux vecteurs de l’espérance, le monde se courbe, ouvre les fissures de la compassion, les promesses secrètes d’une humanité qui s’examine, écoute son corps et ses remords, reconnaît, et possiblement s’amende. Se plier, se tenir, pour mieux affermir aussi sa dignité, tracer fermement les lignes du droit et de la justice dans le sable de l’à-quoi-bonisme généralisé, et se tenir, digne, humain, devant Dieu.
Chers amis, chercher une réponse à la question de ce que nous célébrons réellement m’a conduit à partager avec vous deux sources vives de la tradition, deux vecteurs de l’espérance, dont j’espère que chacun pourra récupérer quelques étincelles dans le génie de Kippour…
Se plier et se tenir, se plier pour mieux se tenir, telle sera, sans doute, la morale de la petite histoire par laquelle je vais maintenant conclure, en restant dans le domaine de la confection, pour faire honneur à nos trois pantalons de départ.
Dans les années 30, Shmouel, arrivant directement d’Europe de l’est, de son Shtetl, monte sa petite boutique de tailleur dans la rue de Turenne, déserte à l’époque. Clouant fièrement la pancarte qui lui sert d’enseigne, il y inscrit : « Shmouel, le meilleur tailleur de la ville ». Peu après arrive Ruben, d’un village voisin, qui lui aussi s’installe rue de Turenne et monte sa petite boutique… Voyant que le créneau de l’excellence bat son plein, sa pancarte surenchérit en toute modestie : « Ruben, le meilleur tailleur du pays ». Nos amis tailleurs se succèdent ainsi, et chacun, contraint à la surenchère par la pléthore d’enseignes déjà présentes, embouteillent rapidement la rue d’un invraisemblable florilège de superlatifs : « Le meilleur tailleur, d’Europe, du monde, de l’univers, et même, de l’univers et d’ailleurs… !
Arrive enfin David, non moins déterminé que ses confrères mais fort embarrassé par la cacophonie de pancartes qui obscurcit désormais la rue entière. Il ne renonce nullement, bien sûr, à ouvrir sa boutique, et placidement, plante le dernier clou de son enseigne : « David, le meilleur tailleur de la rue »…
Se plier pour mieux se tenir… Chers amis, il y a toujours un petite place pour l’intelligence !
Gmar ‘hatimah tovah !
Soyez inscrits dans le livre de la vie !
[1] Roberto Juarroz, « poésie et réalité », in Roberto Juarroz, Poésies verticales I-II-III-IV-XI, Editions Gallimard, Paris, 2021 [p. 297-345], p. 323.
[2] Albert camus, Le mythe de Sisyphe, Gallimard, Folio, 1981, p. 30.
[3] Nietzsche, Aurore, aphorisme 174.
[4] Jean-François Mattéi, L’Homme dévasté. Essai sur la déconstruction de la culture, Editions Grasset & Fasquelle, Paris, 2015, p. 47.
[5] Milan Kundera, La Plaisanterie ; cité par Jean-François Mattéi, L’Homme dévasté. Essai sur la déconstruction de la culture, Editions Grasset & Fasquelle, Paris, 2015, p. 29.